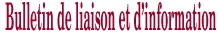Le nouveau régime cherche à étendre son pouvoir en réduisant les poches de dissidence et en concluant un « accord de paix » avec la principale force politico-militaire échappant à son contrôle : l'administration autonome du Nord-Est de la Syrie, à dominante kurde.
Le 6 mars, un groupe de partisans de l'ancien président déchu a lancé une attaque contre les milices pro-gouvernementales à Jable, près de Lattaquié, berceau de la minorité alaouite. Le nouveau gouvernement a dépêché sur place des renforts, y compris des milices alliées islamistes comprenant de nombreux ex-djihadistes de Daech, recyclés mais farouchement hostiles aux « hérétiques alaouites ». Les affrontements avec les partisans pro-Assad auraient fait au moins 481 morts dans les deux camps selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Les milices islamistes se sont alors déchaînées contre la population civile alaouite, massacrant avec une sauvagerie digne de Daech femmes et enfants. Selon l'OSDH, « le nombre total des martyrs civils liquidés s'élève à 973, y compris des femmes et des enfants ». L’ONU évoque des « meurtres, des exécutions sommaires et des opérations de nettoyage ethnique » perpétrés « par les forces de sécurité et des groupes alliés » (Le Monde, 10 mars).
Réagissant à ce carnage, le président par intérim Ahmad Al-Charaa a annoncé, le 10 mars, la formation d'une commission d'enquête indépendante sur « les exactions contre les civils », afin d'en identifier les responsables et de les traduire en justice. « Nous demanderons des comptes (...) sans indulgence à toute personne impliquée dans l'effusion de sang des civils », a-t-il assuré dans une vidéo diffusée par l'agence de presse officielle SANA. Promesse qui risque de rester sans lendemain dans l'état sécuritaire chaotique de la Syrie.
Lors d'un sermon, le 9 mars, le patriarche orthodoxe d'Antioche, Jean X, a indiqué que les « massacres avaient aussi tué de nombreux chrétiens innocents ». « La majorité des victimes étaient des civils innocents, dont des femmes et des enfants », a-t-il affirmé.
De son côté, l'administration autonome kurde de Syrie a condamné des « pratiques qui nous ramènent à une époque noire que le peuple syrien ne veut pas revivre ». C'est sans doute pour éviter de tels affrontements que les Kurdes ont conclu, le 10 mars, avec le nouveau pouvoir un « accord de paix » prévoyant l'intégration progressive de leur administration, de ses institutions civiles et militaires, dans les structures de l'État syrien. C'est avec les encouragements et grâce à la médiation américaine que cet accord a été signé par le président par intérim Al-Charaa et le commandant en chef des Forces démocratiques syriennes (FDS), le général Mazloum Abdi, qui s'est rendu pour l'occasion à Damas par un hélicoptère de l’US Air Force.
Cet accord a été salué par la communauté internationale, y compris les États-Unis, qui ont déclaré qu’ils « réaffirment leur soutien à une transition politique garantissant une gouvernance crédible et non sectaire comme meilleure voie pour prévenir de nouveaux conflits. »
Texte de l’accord de paix
L’accord kurdo-syrien comprend les dispositions suivantes :
Cet accord a été accueilli favorablement par la population kurde, qui espère que les alliés occidentaux veilleront à son respect et s’impliqueront plus activement pour empêcher les incursions turques. Dans un entretien téléphonique avec le leader kurde Massoud Barzani, me 11 mars, le général Mazloum Abdi a souligné l'importance de l'unité kurde dans la période critique actuelle. Barzani a réitéré « son soutien à tout pas qui favorise la paix et la stabilité en Syrie, et la reconnaissance des droits légitimes du peuple kurde ». De son côté, le président turc Erdogan, lors d'un dîner de rupture du jeûne du Ramadan, le 11 mars, a déclaré : « La mise en œuvre intégrale de l'accord conclu hier va servir la sécurité et la paix en Syrie. Tous nos frères syriens en sortiront gagnants » (AFP, 11 mars). Cependant, malgré cette déclaration de bonnes intentions, les milices syriennes pro-turques ont poursuivi leurs attaques dans les environs du barrage de Tishrin.
Une frappe de drone turc, a ciblé des habitations civiles dans le village de Jarraf, au sud de Kobané, tuant un enfant de 13 ans et blessant deux autres personnes. Près du barrage de Tishreen, des avions de chasse turcs ont bombardé le village de Khirbet al-Zamala, tandis que des tirs d’artillerie lourde ont visé les villages environnants. Par ailleurs, des forces soutenues par la Turquie ont tenté une attaque à l’aide de drones suicides, dont quatre ont été abattus par les forces de défense.
Le 17 mars, un drone turc a frappé une zone située entre les villages de Qomji et Barkh Botan, au sud de Kobani, tuant neuf civils d'une même famille, dont plusieurs enfants, et en blessant deux autres. Les victimes travaillaient sur leurs terres agricoles lorsque l'attaque a eu lieu (Le Figaro, 18 mars).
Selon les FDS, la Turquie continue d'intensifier ses activités militaires dans le nord et l'est de la Syrie, malgré les efforts internationaux en cours pour négocier un cessez-le-feu à l'échelle nationale. En plus de lancer des attaques répétées, la Turquie étend secrètement sa présence militaire en construisant de nouvelles bases sous le couvert de la nuit, en particulier dans les zones situées au sud et à l'est de Manbij et autour de Kobani. Les sites clés comprennent la colline de Qara Qwzaq, la rive ouest de l'Euphrate et le village de Hassan Agha.
Le 17 mars, l'Union européenne a organisé à Bruxelles sa neuvième conférence internationale de soutien à la Syrie. Outre les pays engagés, plusieurs pays arabes ont participé à cette conférence. L'Union européenne va débloquer quelque 2,5 milliards d’aides humanitaires et d’assistance pour le rétablissement des services fondamentaux. Au total, la communauté internationale espère mobiliser près de 6 milliards d’euros. Les États-Unis, qui ne reconnaissent pas le nouveau régime syrien, ne participeront pas à cet effort de solidarité. Les donateurs européens vont conditionner leur aide au progrès du processus politique en cours, veillant notamment à son caractère inclusif, au respect des droits des minorités et au statut des femmes.
Dans son entretien accordé à la chaîne kurde Rudaw, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a réaffirmé la position ferme de l'Allemagne sur le soutien aux droits des Kurdes, en particulier dans le contexte de l'avenir de la Syrie. Elle a salué le rôle des Kurdes dans la défaite de Daech et a souligné que leur identité, leur langue et leur sécurité devaient être reconnues dans toute future constitution syrienne. Mme Baerbock a également souligné l'importance de l'unité kurde dans la prise de décision politique. Dans le même temps, elle a précisé que l'Allemagne ne financerait pas les groupes islamistes en Syrie et que la poursuite du soutien allemand à la reconstruction et à l'aide dépendait d'un processus politique inclusif et démocratique. Elle a averti les nouveaux dirigeants intérimaires syriens que les mots ne suffisent pas et que l'Allemagne ne soutiendra que des actions réelles en faveur de la stabilité, des droits et de l'inclusion.
L’aide européenne vise aussi à favoriser le retour des réfugiés syriens vers le pays. Selon les chiffres publiés par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 1,2 million de Syriens sont retournés dans leur région d’origine depuis décembre dernier, dont 885 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays et 302 000 réfugiés. Le HCR s’attend à ce que jusqu’à 3,5 millions de réfugiés et déplacés internes rentrent chez eux cette année, ce qui « souligne le besoin d’investissements urgents dans le soutien au rétablissement et à la réintégration », estime Adam Abdelmoula, le coordinateur résident et humanitaire des Nations unies pour la Syrie (Euronews, 24 mars).
Intervenant lors de la Conférence de Bruxelles sur la Syrie du 17 mars, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a souligné la nécessité de réformes globales et durables garantissant les droits de tous les citoyens syriens. « Comment faire en sorte que, lorsque les gens retournent dans leurs communautés, ils disposent de suffisamment d’éléments de base : abris, électricité, eau, assainissement, éducation, emploi — en bref, comment assurer leur sécurité et le respect de leurs droits ? Car sans sécurité, il n’y a pas d’opportunités », a-t-il ajouté.
Assurer la sécurité et la stabilité nécessite avant tout un cadre juridique stable, une constitution et des lois garantissant l’égalité des droits et les libertés publiques, un gouvernement légitime issu d’élections libres. Un gigantesque défi dans un pays fragmenté et en ruines. Le nouveau régime syrien ne semble pourtant pas prendre le temps nécessaire pour consulter les forces politiques et les représentants de la société civile afin d’élaborer un consensus et définir un calendrier électoral réaliste.
Déclaration constitutionnelle
Le 13 mars, le président par intérim Al-Charaa a signé une « déclaration constitutionnelle » tenant lieu de constitution temporaire. Celle-ci accorde au président intérimaire pleins pouvoirs y compris le pouvoir exécutif, le pouvoir de déclarer l’état d’urgence. Il nommera un tiers des membres du Parlement intérimaire, les deux autres tiers devant être proposés par des commissions électorales elles-mêmes supervisées par un comité nommé par le président.
En somme, le président par intérim va cumuler avec ses fidèles l’ensemble des pouvoirs exécutif et législatif. La justice sera « indépendante » sous l’autorité d’une cour constitutionnelle dont les membres seront nommés par le président par intérim lui-même, sans l’approbation d’aucune autre institution. Selon cette « constitution » temporaire, le président de la Syrie doit être musulman et la loi islamique (charia et jurisprudence sunnite) sera la source principale de la législation, tout en garantissant « la liberté de croyance ».
Cependant, tous les droits, y compris la liberté de culte, peuvent être restreints s’ils sont considérés comme portant atteinte à la sécurité nationale et à l’ordre public. Le nom du pays reste « République arabe syrienne », une république autocratique et islamique, discriminatoire envers ses citoyens non musulmans et non arabes. Ce régime « intérimaire » devrait durer au moins cinq ans, le temps de rédiger une nouvelle constitution et d’organiser des élections (New York Times, 14 mars).
Cette « constitution » temporaire, accompagnée d’un calendrier électoral digne d’une junte militaire, a déçu de nombreux Syriens et provoqué la colère d’autres forces politiques. L’administration autonome kurde, dans un communiqué, a rejeté cette « déclaration constitutionnelle » qui, selon elle, ne fait que « reproduire l’autoritarisme sous une nouvelle forme » et sabote les contre-pouvoirs. Elle déclare qu’elle ne respectera pas les dispositions de cette « constitution » proclamée sans consultation ni consentement populaire.
Faisant fi de ces critiques et fort du soutien de son parrain turc, le président syrien par intérim a annoncé, le 29 mars, la formation d’un nouveau gouvernement sans Premier ministre, dans lequel ses fidèles occupent les principaux postes, mais qui se veut « inclusif » et compte une femme chrétienne. Les 23 ministres ont prêté serment devant Al-Charaa lors d’une cérémonie retransmise par la télévision. Outre Mme Hind Khabawat, chrétienne, nommée ministre des Affaires sociales et du Travail, le cabinet compte un ministre druze, un autre kurde et un alaouite qui ne représentent aucune force politique.
Le 30 mars, l'Administration autonome de la Syrie du Nord et de l'Est (AANES) a fermement rejeté le nouveau gouvernement formé à Damas, déclarant qu'il ne reflétait pas la diversité de la Syrie et poursuivait les mêmes politiques d'exclusion et de centralisation que le régime précédent. Dans une déclaration, les Kurdes syriens ont souligné que tout gouvernement qui n'inclurait pas une représentation équitable et significative de toutes les composantes ethniques, religieuses et politiques de la Syrie ne ferait qu'aggraver la crise, au lieu de la résoudre. Ils ont déclaré qu'ils ne reconnaîtraient ni ne mettraient en œuvre les décisions prises par un gouvernement qui marginaliserait des communautés comme la leur. Réaffirmant son engagement en faveur d'une Syrie démocratique et décentralisée, l’AANES a appelé à un processus politique inclusif qui respecte la citoyenneté, l'égalité de participation et la fin de la domination d'une seule faction.
Réagissant à ces critiques, le président par intérim a déclaré à la télévision syrienne: « On ne pourra pas satisfaire tout le monde. Chaque mesure que nous prenons ne fera pas consensus, c’est normal, mais nous devons parvenir à un consensus autant que possible » (AFP, 31 mars).
Dans ce contexte, les chances que l'accord de paix kurdo-syrien soit respecté paraissent pour le moins hypothétiques.
Affaibli par l'usure du pouvoir et par une crise économique et sociale qui ne cesse de s'aggraver, le président turc s'accroche et se prépare à solliciter un troisième mandat. À cette fin, il veut modifier la Constitution qui n'autorise que deux mandats présidentiels et éliminer tous ceux qui pourraient contrarier ses ambitions et son pouvoir de plus en plus autocratique et répressif.
Après avoir destitué 11 maires kurdes démocratiquement élus en l'espace d'un an sous l'accusation de "liens avec une organisation terroriste", il a décidé de s'en prendre à son principal opposant politique, le populaire maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, pressenti par son parti, en février 2023, comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Le président turc, qui contrôle l'appareil judiciaire et l'utilise à loisir contre ses adversaires, a mis en branle le processus d'élimination politique d'Imamoglu. Poursuivi dans cinq procédures judiciaires sous des prétextes aussi inconsistants que « atteinte à l'indépendance de la justice » ou « insulte au Haut Conseil électoral » (dont il avait critiqué le manque d'impartialité), le maire d'Istanbul a vu son diplôme universitaire obtenu il y a 30 ans invalidé par le conseil d'administration de l'université d'Istanbul.
Décision ubuesque qui, si elle était confirmée en appel par la justice, l'empêcherait de se porter candidat au poste de président de la République, car selon la Constitution turque, seuls les titulaires d'un diplôme universitaire peuvent briguer ce poste. Ekrem Imamoglu avait fait une licence en gestion administration dans une université privée de Chypre du Nord, sous occupation turque, avant d'être admis sur équivalence de titre à l'université d'Istanbul, où il a pu compléter ses études et obtenir son diplôme. Le conseil d’université décide, trois décennies plus tard, que cette reconnaissance d'équivalence était « irrégulière ».
Cet imbroglio administratif n'est pas sans rappeler la contestation du diplôme universitaire du président Erdogan lui-même, qui serait un faux. En effet, lors des élections présidentielles de 2014, un certain Ömer Basoglu a déclaré à la presse avoir terminé ses études en 1981 à la même date que Recep Tayyip Erdogan, dans la même faculté de l'université de Marmara à Istanbul, et assure qu'il ne l'a jamais côtoyé. Dans une vidéo de 5 minutes, il accuse le président turc d’être un faussaire (Le Monde, 19 mars 2021). Ce témoin gênant est mort sept mois plus tard dans des circonstances non élucidées.
Au lendemain de cette tentative d'invalidation de son diplôme, le 19 mars, Ekrem Imamoglu a vu son domicile encerclé par une vingtaine de véhicules de police. Il a commenté en direct sur les réseaux sociaux cette descente de police brutale et accusé les autorités d'utiliser la police à des fins politiques. Appréhendé à 7h30, il a été amené pour interrogatoire dans les locaux de la direction générale de la police. La police a également interpellé un centain nombre de ses collaborateurs, dont le conseiller de presse Murat Ongün, le maire du district de Sisli Resul Emrah Sahan, et le secrétaire général adjoint de la municipalité Mahir Polat.
Dans un premier communiqué, le parquet général, dans le cadre d'une enquête de corruption, accuse Ekrem Imamoglu d'être "à la tête d'une organisation criminelle à but lucratif", de fraude aggravée et de trucage d'appel d'offres. Puis, dans un deuxième communiqué, le procureur affirme que "M. Imamoglu, avec les autres suspects, a commis le crime d'aider l'organisation terroriste PKK-KCK". Cette accusation permet aux autorités de remplacer un maire élu par un administrateur. Craignant des réactions de la population, le gouvernement, par le biais du préfet d'Istanbul, a interdit toute manifestation sur la voie publique pendant quatre jours, fermé plusieurs stations de métro du centre d'Istanbul, barré des voies d'accès à la mairie et restreint l'accès aux réseaux sociaux.
Les réactions à ce fait du prince, impensable dans une démocratie digne de ce nom ne se sont pas fait attendre, tant en Turquie qu'à l'étranger. Le président du CHP (Parti républicain du peuple), en déplacement, a immédiatement regagné Istanbul et dénoncé un véritable "coup d'État", à trois jours d'une primaire destinée à investir Imamoglu comme candidat officiel de son parti pour la prochaine élection présidentielle. À l'appel du CHP, parti fondateur de la République turque et principale formation de l'opposition, de vastes rassemblements populaires se sont formés à Istanbul, devant la mairie, et dans une cinquantaine de grandes villes du pays. Le 21 mars, jour du Nouvel An kurde, plus d’un million de Kurdes ont célébré Newroz dans le district de Kumkapı d’Istanbul et un autre million de manifestants dans un autre district, pour protester contre l'arrestation d’Imamoglu et la dérive despotique d’Erdogan. Il s'agit des manifestations populaires les plus importantes depuis celles du Parc Gezi à Istanbul en 2013. Les jeunes, qui n'ont connu comme président que Recep Tayyip Erdogan, très inquiets pour leur avenir, y ont massivement participé.
Malgré un usage immodéré de gaz lacrymogènes et de canons à eau, les manifestations n'ont pas été dispersées. Le 23 mars, un juge de garde a ordonné l'incarcération du maire d’Istanbul en détention provisoire pour "corruption". Il a en revanche écarté l'accusation de "terrorisme". Ekrem Imamoglu et ses collaborateurs ont été conduits par un convoi sécurisé, escorté de voitures de police, à la gigantesque prison de Silivri, où ils ont été placés en détention provisoire. Leurs avocats ont fait appel de cette décision judiciaire expéditive. Le ministre turc de l’Intérieur a aussitôt suspendu le maire d’Istanbul de ses fonctions. Le conseil municipal s’est réuni le 26 mars pour élire à sa place un maire-adjoint.
Le vote pour la primaire du CHP s’est tenu comme prévu le 23 mars, mais il s’est transformé en plébiscite, avec 15 millions de votants en faveur d’Imamoglu, dont 13,2 millions de personnes non affiliées au CHP selon le décompte officiel de la consultation (Le Monde, 24 mars). Le CHP avait appelé tous les citoyens à y prendre part. Commentant les résultats, le leader du CHP, Özgür Özel, a déclaré : "Ekrem Imamoglu est en route pour la prison, mais il est aussi en route vers la présidence." De son côté, E. Imamoglu a salué ce résultat : "Des dizaines de millions de personnes dans ce pays, qui souffrent de l'oppression du gouvernement, d'une économie ruinée, de l'incompétence et de l'anarchie, se sont précipitées aux urnes pour dire : ‘Erdoğan, ça suffit !’ Les urnes viendront, la nation donnera à ce gouvernement une gifle inoubliable."
Le 29 mars, à Maltepe, sur la rive asiatique du Bosphore, s’est tenu le plus grand rassemblement protestataire des dernières décennies en Turquie. Selon la presse, la mobilisation a réuni près de 2,2 millions de personnes. La démonstration de force de l’opposition s’est déroulée dans le calme, sans incident. La foule a dénoncé le coup d'État politique d'Erdogan, l’instrumentalisation de la justice, les violences policières. Plusieurs orateurs ont annoncé que cette marche vers le pouvoir allait se poursuivre. Plusieurs journalistes couvrant ces manifestations ont été arrêtés, dont un envoyé spécial du quotidien suédois Dagens ETC, Joakim Medin. L'envoyé de la BBC britannique, Mark Lowen, a été expulsé (New York Times, 27 mars). Selon un décompte cité par Le Monde du 31 mars, "plus de 2000 personnes ont été arrêtées depuis le début du mouvement". L'ampleur de la contestation et sa répression déstabilisent le parti d’Erdogan. Dans sa couverture des événements, la presse internationale titre : « La Turquie bascule dans l’autocratie » (The New York Times, 22 mars), « Erdogan accentue son virage autoritaire » (Le Figaro, 26 mars), « Le pouvoir bride les médias » (Le Monde, 27 mars).
Dans son édition du 28 mars, The New York Times relève que pour certains autocrates, des élections truquées peuvent être une menace de trop. Dans la même édition, le journal publie une tribune du maire incarcéré, intitulée : I am Erdogan’s Main Challenger in Turkey. I was arrested.
Les réactions internationales à l’arrestation du maire d’Istanbul ont, dans l’ensemble, été modérées. Aucun État ne souhaitant affronter publiquement Erdogan. L’Allemagne a certes protesté par la voix de la ministre des Affaires étrangères, « l’incarcération du maire d’Istanbul et de nombreuses autres personnalités constitue une atteinte grave à la démocratie », a déploré le 23 mars le ministère des Affaires étrangères français, rappelant que la Turquie est membre du Conseil de l’Europe et État candidat à l’adhésion à l’Union européenne. Celle-ci, pour sa part, s’est contentée d’exprimer sa "préoccupation". La maire de Paris a dénoncé en des termes plus fermes l’arrestation de son collègue et ami. Plusieurs maires de grandes villes européennes ont suivi l’exemple de Mme. Anne Hidalgo.
Dans les turbulences provoquées par l’arrestation et l’incarcération d’Ekrem Imamoglu, la dissolution pour "propagande terroriste" du Conseil de l’ordre du barreau d’Istanbul, le 21 mars, est passée inaperçue. Le bâtonnier d’Istanbul et les membres de son conseil de l’ordre, poursuivis pour "propagande terroriste" et "diffusion publique de fausses informations", ont été relevés de leurs fonctions par une décision de la justice turque. Celle-ci leur reproche d’avoir réclamé une enquête sur la mort, fin décembre en Syrie, de deux journalistes turcs, visés par un drone turc, selon une ONG, dans une zone où des factions pro-turques affrontaient des combattants kurdes. "Aujourd’hui est un jour sombre. En ce palais de justice, nous avons peut-être assisté à l’effondrement du futur de la Turquie", a déclaré le bâtonnier d’Istanbul, Ibrahim Kaboglu, à la sortie du tribunal. "Personne n’a le pouvoir de faire taire les barreaux", a déclaré de son côté le président de l’Union des barreaux de Turquie, Erinc Sagkan, dénonçant une "décision honteuse" (AFP, 21 mars).
Un bâtonnier destitué pour avoir réclamé une enquête sur le meurtre d’un journaliste kurde, et un maire d’Istanbul arrêté manu militari au petit matin, placé en garde à vue, puis incarcéré pour corruption sans un procès contradictoire sans appel. Voilà deux images qui, à deux jours d’intervalle, résument l’esprit et le fonctionnement de la justice indépendante turque.
Dans ce mois politiquement chargé et turbulent, le "processus de paix" n’a pas connu de développement significatif. Si, répondant à l’appel de son fondateur Öcalan, incarcéré dans l’île-prison d’Imrali, le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) a bien déclaré, le 1er mars, un "cessez-le-feu" unilatéral afin de préparer progressivement son congrès appelé à statuer sur une éventuelle dissolution, l’armée turque n’a pas tenu compte de ce cessez-le-feu et a poursuivi ses opérations militaires contre les positions de la guérilla kurde dans les zones frontalières du Kurdistan irakien (New York Times, 12 mars).
Le « parrain » de ce processus, Devlet Bahçeli, leader du Parti d’Action nationaliste (MHP), allié du président Erdogan, a déclaré le 9 mars « l’organisation terroriste PKK et les groupes affiliés doivent immédiatement et sans conditions préalables déposer les armes » (AFP, 9 mars). En réponse, l’un des hauts dirigeants du PKK, Cemil Bayik, dans un entretien accordé à la chaîne de télévision kurde Stêrk TV, affirme : « Chaque jour, des avions de reconnaissance turcs volent, chaque jour ils bombardent, chaque jour ils attaquent. Tenir un congrès dans ces conditions est impossible et dangereux. Mais ce congrès aura lieu si les conditions sont remplies » (Le Figaro, 14 mars).
Celles-ci feront, sans doute, l’objet des discussions que la délégation du parti pro-kurde DEM devrait avoir, après les élections locales en avril, avec le président turc Erdogan. En attendant, cette délégation fait le tour des principaux partis turcs et des organisations de la société civile pour les "briefer" et préparer le terrain à une solution politique promise et espérée.
Les dirigeants iraniens sont placés devant un choix implacable par le président américain Donald Trump. Dans une lettre adressée au Guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, reçue le 12 mars à Téhéran, le président américain sommerait l'Iran d'engager des négociations dans un délai de deux mois, faute de quoi "la probabilité d'une action militaire américaine ou israélienne contre les installations militaires iraniennes augmenterait considérablement".
Face à ce dilemme, les responsables iraniens semblent divisés. Dans son discours pour le nouvel an iranien, le 21 mars, l'ayatollah Khamenei a réaffirmé son opposition à toute négociation avec les États-Unis, malgré la situation critique dans laquelle se trouve le pays. « Les Américains doivent comprendre qu'ils n'obtiendront rien par la menace lorsqu'ils traitent avec l'Iran », a-t-il ajouté. L’ayatollah a affirmé que négocier avec les États-Unis n'est « ni raisonnable, ni intelligent, ni honorable ». Il reconnaît cependant que la menace grandissante de la guerre depuis le retour de Donald Trump, dont la politique de "pression maximale" est alignée sur celle d'Israël, pèse lourd. "Si quelqu'un agit avec malveillance et commence un conflit, qu'il sache qu'il recevra de sévères gifles", a-t-il averti devant une foule de ses partisans réunis à Téhéran.
Pour le Guide suprême, les États-Unis, qui se sont retirés d'un précédent accord sur le nucléaire, ne sont pas fiables. Le traitement réservé récemment au président ukrainien Zelensky à la Maison-Blanche illustre, à ses yeux, ce manque de fiabilité des Américains, y compris envers leurs alliés.
D'autres dirigeants iraniens, comme le président Massoud Pezeshkian, son prédécesseur Hassan Rohani ou l'ancien ministre des Affaires étrangères Mohammad Djavad Zarif, plaident ouvertement en faveur des négociations dans le but d'écarter le danger réel d'une confrontation militaire avec Israël, soutenu par les États-Unis, et pour obtenir une levée même partielle des sanctions afin de remédier à la situation économique dramatique du pays. Le retrait américain de l'accord de 2015 et les sanctions de pression maximale imposées à la suite auraient coûté à l'Iran plus de 800 milliards de dollars. Le pays souffre de pénuries dans tous les domaines. En un an, le prix du kilo de riz a été multiplié par 100, celui des légumes par 200, tandis que la monnaie nationale a perdu 60 % de sa valeur. Le mouvement « Femme, vie, liberté » a considérablement affaibli la base sociale du régime. Les frappes israéliennes ont grandement réduit les systèmes de défense anti-aériens, y compris ceux censés protéger les sites nucléaires. Une nouvelle confrontation militaire finirait d'anéantir ces installations, selon les experts. Le système de défense par procuration avec des milices pro-iraniennes au Liban, en Syrie, en Irak est lui aussi très largement décapité.
Un "deal" cher au président américain permettrait d'avoir un répit, de renflouer les finances au prix de concessions sur le programme nucléaire, estiment les pragmatiques de Téhéran soucieux de sauver le régime.
Dans ce bras de fer feutré, le vieil ayatollah, après avoir marqué sa posture dure et ses mises en garde, pourrait laisser les modérés pragmatiques engager des négociations indirectes ou même directes avec les États-Unis, quitte à leur reprocher ensuite les conséquences négatives de ces négociations sous la menace, ou leur échec.
L'ayatollah Khamenei n'est d'ailleurs pas le seul à stigmatiser le manque de fiabilité et l'imprévisibilité de l'administration américaine. Le Monde du 19 mars relate que la fermeture de l’Agence des États-Unis pour le développement international, le 3 février, a eu un impact massif sur les missions des journalistes et des dizaines d'ONG œuvrant pour la démocratie, l'environnement ou l'égalité en Iran. Une décision saluée par les médias officiels en ces termes : « La suppression du budget et la fermeture des médias anti-iraniens, dont l'unique objectif était de noircir l'image de l'Iran, propager des mensonges et diffuser de fausses informations, montrent que l'administration Trump ne veut pas gaspiller d'argent pour des causes inutiles. » Voilà donc un point d'accord inattendu entre Téhéran et Washington !
Pendant ce temps, la répression des opposants et dissidents s'est poursuivie tout au long du mois de mars. Voici une brève chronique de la répression au Kurdistan établie par l'ONG des droits humains Hengaw.
Le 1er mars les autorités ont arrêté à Mashhad Javad Alikordi, un avocat kurde, qui avait défendu plusieurs prisonniers politiques, il a été arrêté après avoir refusé une convocation informelle des services de renseignement pour commencer sa peine de prison. Il avait été condamné à 16 mois d’emprisonnement, à une interdiction de pratiquer le droit pendant deux ans, et à une interdiction de voyager, pour « formation et direction d’un groupe visant à renverser le régime ».
À Kermanshah, Mojtaba Vaisi, militant kurde et adepte de la foi Yarsan, a été violemment arrêté par les forces du CGRI le 5 mars alors qu’il préparait les célébrations de Newroz (Nouvel An kurde). Sa jeune fille aurait été laissée seule sur les lieux, soulignant la brutalité de l’arrestation.
Par ailleurs, Motalleb Ahmadian, prisonnier politique kurde originaire de Baneh, entame sa 15e année d’une peine de 30 ans d’emprisonnement. Dans une lettre adressée au Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits humains en Iran, Ahmadian a décrit la dégradation de sa santé en raison du refus de soins médicaux. Arrêté en 2010, il a été condamné pour appartenance présumée au Parti Komala du Kurdistan iranien et a été soumis à la torture et à l’isolement prolongé.
Le 4 mars, les forces de renseignement iraniennes ont arrêté Behrouz Farhang, un tailleur kurde de Bukan, dans son atelier. Il a été transféré dans un centre de détention du CGRI à Urmia, sans que les charges retenues contre lui soient connues. De même, Mahmoud Naderi, habitant du district de Kalatrazan à Sanandaj, a été arrêté après plusieurs convocations en raison de l’utilisation symbolique de vêtements traditionnels kurdes « Jamaneh » et « Vêtements khaki » lors du mariage de son fils – des habits liés à l’identité culturelle et à la résistance kurdes. Arazu Jalilzadeh, enseignante kurde de Sardasht, a également été arrêtée le 3 mars. Elle aurait été emmenée violemment depuis le domicile de son père.
Le 8 mars, les forces de sécurité ont arrêté Fakhraddin Taheri, un jeune Kurde de Piranshahr, lors d’un raid violent au domicile familial. Les forces du ministère du Renseignement auraient fait irruption sans mandat judiciaire, brisant portes et fenêtres avant de l’emmener vers un lieu inconnu.
Le 10 mars 2025, les forces de sécurité ont arrêté au moins quatre militantes kurdes des droits des femmes pour leur participation à des événements de la Journée internationale des droits des femmes à Sanandaj et Dehgolan. Parmi elles se trouvait Sohaila Motaei, une figure connue du mouvement Jin, Jiyan, Azadi (Femme, Vie, Liberté). Motaei, déjà emprisonnée par le passé pour son activisme, a été arrêtée à Dehgolan par le ministère du Renseignement.
Les autres personnes arrêtées ce jour-là incluent Baran Saeidi, enlevée de force à son domicile, Soma Mohammadrezaei, arrêtée sur son lieu de travail au centre commercial Almas, et Leila Pashaei, appréhendée au domicile familial. Les quatre femmes ont été transférées vers un lieu inconnu, et leur situation actuelle reste inconnue.
Le 12 mars, les forces de sécurité à Saqqez ont arrêté Abdollah Ahmadzadeh, membre de l’Association culturelle « Halabja ». Ahmadzadeh jouait un rôle central dans l’organisation de commémorations pour les victimes de l’attaque chimique de Halabja. Son arrestation s’inscrit dans un schéma de répression de l’expression culturelle kurde par les autorités iraniennes.
Par ailleurs, les forces iraniennes poursuivent leurs attaques contre les porteurs frontaliers kurdes (kolbars). Le 7 mars, Ahmad Karimzadeh, un kolbar kurde de Baneh, a été grièvement blessé par balles par les gardes-frontières. Le ciblage des kolbars – qui transportent des marchandises à travers les frontières occidentales de l’Iran pour survivre économiquement – est un problème de longue date, les autorités ayant régulièrement recours à la force létale contre eux.
Dans une vaste répression à travers le Kurdistan iranien, les forces de sécurité du régime iranien ont arrêté, harcelé et intimidé de nombreux citoyens kurdes simplement pour avoir célébré Newroz, le Nouvel An kurde. Selon les données compilées par l'Organisation Hengaw pour les Droits de l'Homme, au moins 41 individus, dont six enfants et plusieurs femmes, ont été arrêtés au 21 mars — avec de nombreuses autres détentions dans les jours suivants, alors que la répression s'intensifiait jusqu'au 30 mars. (hengaw.net)
Les arrestations ont eu lieu dans plusieurs villes à majorité kurde, notamment Marivan, Sardasht, Urmia, Sanandaj, Saqqez, Piranshahr, Shino et Kermanshah. En plus des détentions, des milliers d'autres auraient été convoqués pour interrogatoire ou menacés par les agences de renseignement dans le but de réprimer la participation à cette célébration annuelle — une expression profondément symbolique de la culture, de l'identité et de la résistance kurdes.
Parmi les personnes détenues figuraient de jeunes enfants et adolescents, tels qu'un garçon de 10 ans et un autre de 14 ans de Sardasht, ainsi que Keyhan Tadberi, 17 ans, qui aurait été sévèrement battu avant d'être emmené dans un centre de détention à Sanandaj. À Urmia, deux sœurs adolescentes, Avin Ahmadi, 16 ans, et Sariya Ahmadi, 17 ans, ont été arrêtées après avoir porté des vêtements traditionnels kurdes ornés du drapeau du Kurdistan. Leur cousine, Rojbin Afsoon, 22 ans, a également été détenue et reste portée disparue.
Un poète et aîné culturel de 78 ans, Saifollah Khan Ghafari Bashbolagh, a été arrêté à Saqqez après avoir récité un poème sur la liberté lors d'une cérémonie de Newroz. Il a ensuite été accusé de "trouble à l'ordre public".
Des militants civils, dont le couple marié Shno Mohammadi et Sahab (Ariwan) Shakeri, ont été arrêtés à leur domicile à Sanandaj lors d'une descente de police menée sans mandat. Leur localisation reste inconnue, et les autorités ont refusé de fournir des informations à leur famille (hengaw.net).
Le militant religieux Cheikh Zahid Shahabi a été détenu après avoir pris la parole et allumé le feu symbolique de Newroz lors d'une cérémonie pacifique à Saqqez. Son Khaniqah (couvent soufi) nommé le « Chemin vers la Liberté » a été perquisitionné par les forces de renseignement, et des livres religieux ont été jetés dans la rue. L'arrestation de Zahid est survenue quelques mois après l'assassinat de son frère, Azad Shahabi, dans ce que les membres de la société civile ont décrit comme un meurtre à motivation politique.
L'artiste et dramaturge Karwan Dafei, 25 ans, a été arrêté dans les rues de Marivan. Sa détention semble être directement liée à son rôle dans l'organisation d'événements culturels pendant la période de Newroz. (hengaw.net)
Un ancien prisonnier politique de Marivan, Tahsin Dadras, faisait également partie des personnes arrêtées, aux côtés de plusieurs autres de la région. Dans de nombreux villages, y compris Ney et Doleh-Garm, des dizaines de résidents ont été convoqués, et plusieurs arrêtés, malgré les tentatives des autorités d'empêcher les rassemblements.
Les détenus comprenaient au moins six enfants et plusieurs femmes, soulignant la nature indiscriminée de la répression — visant des personnes de tous âges, genres et rôles dans la société.
En novembre dernier, l’Irak avait procédé au recensement général de sa population, une première depuis 37 ans. Environ 30 000 enquêteurs dûment formés, dotés d’iPads, ont demandé à chaque habitant du pays pas moins de 70 questions afin d’établir un tableau démographique, économique, social et éducatif du pays. Pour faciliter leur tâche la population était assignée à domicile du 20 au 22 novembre 2024. L’analyse des données ainsi recueillies commence à être publiée. On apprend ainsi que dans la Région du Kurdistan autonome, 84,57 % de la population vit désormais dans les villes et 15,43 % dans les villages. Dans l’ensemble de l’Irak, la population urbaine représente 70,17 %, les ruraux 29,83 %. Le Kurdistan est donc sensiblement plus urbanisé, ce qui est dû en grande partie à la destruction systématique de 4 500 des 5 000 villages kurdes par la dictature de Saddam Hussein. Malgré l’émergence d’un Kurdistan autonome depuis 1991 et la reconstruction progressive de nombreux villages, le monde rural kurde n’a pas pu retrouver sa vitalité d’antan.
La population du Kurdistan est jeune. Les moins de 15 ans représentent 31,68 %, les plus de 65 ans 4,4 %. Le taux d’analphabétisme pour les personnes âgées de plus de 10 ans est de 16,23 % au Kurdistan contre 15,31 % en Irak. Dans l’enseignement primaire et secondaire, la part des élèves est de 51,5 % pour les garçons et 48,5 % pour les filles. La moyenne des diplômés du primaire est de 93 % au Kurdistan contre 88 % en Irak. 82 % des habitants du Kurdistan disposent de l’eau courante à leur domicile, contre 87 % pour l’Irak.
La quasi-totalité des foyers (93 % au Kurdistan, 98 % en Irak) est connectée au réseau électrique. Les coupures fréquentes sont complétées par des sources complémentaires comme des générateurs. Autre élément important du mode de vie : 70,16 % des habitants du Kurdistan sont propriétaires de leur logement (72,15 % en Irak).
On apprend aussi que les célibataires représentent 41 % de la population du Kurdistan, les mariés 55,83 %, les divorcés 0,66 %, les séparés 0,33 % et les veufs et veuves 2,18 %. L’âge moyen de mariage est de 23 ans pour les hommes, 20 ans pour les femmes. 46,06 % des hommes et femmes âgés de plus de 15 ans ont un emploi salarié et 38,18 % des employés travaillent dans la fonction publique et municipale (contre 38,25 % en Irak).
Enfin, le taux de croissance démographique est de 3,5 % au Kurdistan contre 3,7 % dans l’ensemble de l’Irak. Lors du recensement de 1957, l’Irak comptait 6,5 millions d’habitants, en 1965 : 9 millions, en 1977 : 12 millions, en 1987 : 16 millions. En 2024, on a dénombré 46 118 793 habitants, soit 7 fois plus qu’en 1957 !
En mars, les pourparlers pour la formation d’un nouveau gouvernement de coalition du Kurdistan ont fait quelques progrès, mais la promesse d’un accord avant le Newroz n’a pas été tenue.
Les discussions sur la reprise des exportations du pétrole du Kurdistan, suspendues depuis mars 2023, n’ont pas abouti à ce jour. Cela malgré les pressions américaines, notamment un appel du conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Mike Walz, au Premier ministre irakien Mohammed Shiaa al-Soudani.
Un sujet majeur de discussion a été la nomination d’un consultant indépendant chargé d’évaluer les coûts liés à la production et au transport du pétrole. APIKUR a exhorté Bagdad à définir clairement le rôle, les responsabilités et le calendrier de ce consultant. L’association de l’industrie pétrolière a également insisté sur l’importance d’accords financiers transparents, en particulier en ce qui concerne les paiements en suspens, dont 1 milliard de dollars de factures impayées qui restent à régler.
Le 19 mars, Haibat Halbousi, président de la commission du pétrole et du gaz du Parlement irakien, a annoncé que les exportations de pétrole de la région du Kurdistan devraient « reprendre officiellement la semaine prochaine ». Il a souligné les progrès accomplis dans la modification de la loi budgétaire et la conclusion d'accords sur les voies d'exportation passant par le port turc de Ceyhan.
L'Association de l'industrie pétrolière du Kurdistan (APIKUR) a répondu aux remarques de Haibat Halbousi en précisant qu'aucun accord n'a été finalisé pour reprendre les exportations de pétrole de la région du Kurdistan. Le groupe a souligné qu'aucun calendrier officiel n'a été fixé et que des questions techniques, juridiques et politiques essentielles n'ont pas encore été résolues.
Washington commence à s’impatienter et à menacer l’Irak de sanctions. Le 9 mars, l’administration américaine a mis fin à une dérogation accordée à l’Irak pour l’achat d’électricité à l’Iran. Bagdad bénéficiait depuis 2018 d’exemptions pour acheter de l’électricité et du gaz à l’Iran. La décision "garantit que l’Iran ne bénéficie d’aucun degré d’aide économique ou financière", selon l’ambassade américaine dans la capitale irakienne (AFP, 9 mars).
Mis en difficulté, l’Irak pourrait se tourner vers des fournisseurs d’électricité indépendants du Kurdistan ou importer de l’électricité de Turquie, ce qui nécessiterait de nouveaux investissements, en attendant la montée en puissance de la production irakienne.
Le nouvel an kurde, Newroz, a été fêté un peu partout dans toutes les régions du Kurdistan ainsi que dans la diaspora kurde d'Europe, du Caucase et d'Asie centrale.
Cette année, à titre tout à fait exceptionnel, la célébration organisée par L'institut kurde a eu lieu le 24 mars, dans la magnifique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris.
Mme. Anne HIDALGO, maire de Paris, a accueilli plusieurs centaines de Kurdes et des amis des Kurdes avec un discours de bienvenue cordial et chaleureux.
L’eurodéputée kurde, Evin Incir, venue spécialement pour cette occasion, a aussi pris la parole, suivie du sénateur de Paris, Rémi Féraud. Ensuite, pour clore cette séquence, le président de l’Institut kurde a expliqué le sens de Newroz et de son message d’unité et de résistance contre les injustices dans la tradition kurde.
La soirée s’est poursuivie par un riche programme musical animé par le groupe de Semîn Yewsîp, la chanteuse Aysel Boran et le chanteur Dler Garmiyani, venu spécialement d’Erbil.
Dans cette Salle des fêtes historique, éclairée aux couleurs kurdes, les Kurdes, habillés souvent de vêtements traditionnels, ont dansé avec leurs invités jusqu’à tard dans la soirée.
Une autre fête avait déjà eu lieu le 21 mars, à l’initiative de la représentation du KRG, dans une salle parisienne privée, La Palmeraie. Le même soir, une fête a été organisée par la communauté kurde à Rouen. D’autres célébrations auront lieu en province. Parmi les célébrations de Newroz dans la diaspora, celle organisée le 23 mars à Cologne a rassemblé plusieurs milliers de Kurdes, plus de 40 000 selon les organisateurs.
Au Kurdistan, la traditionnelle marche aux flambeaux d’Akrê, le soir du 20 mars, a ouvert les festivités. Le 21 mars, près d’un million de Kurdes ont célébré dans la ferveur le Nouvel An à Diyarbakir (Amed), et presque autant à Istanbul. Les fêtes de Van, Hakkari, Batman et Cizre ont également marqué les esprits. Mais c’est surtout au Kurdistan iranien que la ferveur et l’élan populaires ont été au rendez-vous, dans les célébrations massives à Ourmia, Mahabad, Sanandaj, Bokan ainsi que dans la ville natale de Jina Amini, Saghez.
Newroz, qui symbolise le renouveau et la résistance dans la culture kurde, a souvent coïncidé avec des soulèvements et des actes de défiance tout au long de l'histoire. L'un des moments les plus significatifs des célébrations de Newroz de cette année a eu lieu à Ourmia, où des dizaines de milliers de Kurdes se sont rassemblés dans un événement sans précédent, chantant des chansons kurdes et organisant des concerts dans une puissante démonstration de fierté culturelle. En réponse, le régime iranien a mobilisé des milliers d’Azéris ultra-nationalistes, principalement chiites partisans de la République islamique, pour organiser des manifestations contre les festivités kurdes. Certains de ces groupes sont allés jusqu'à appeler à la violence et aux massacres contre la population kurde, transformant une célébration culturelle pacifique en une incitation à l'hostilité ethnique.
Au Rojava aussi, le Newroz a été célébré avec ferveur et enthousiasme un peu partout.
Fête nationale et fériée en Irak et en Iran, le Newroz pourrait devenir la fête du printemps et de la fraternité en Turquie, selon la promesse du président turc Erdogan. Ainsi, après avoir interdit et réprimé les célébrations de cette fête par le passé jusqu’en 1992, la Turquie tente désormais de la récupérer et de la vider de son esprit de résistance.