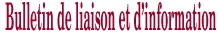L’offensive fulgurante d’une coalition de milices syriennes rebelles lancée le 27 novembre d’Idlib, avec le soutien multiforme de la Turquie, s’est conclue, le 8 décembre, par la prise de Damas. Une dictature sanguinaire qui sévissait depuis plus d’un demi-siècle s’est ainsi effondrée en 12 jours. Le dictateur s’est enfui au petit matin vers une base militaire russe d’où il a été évacué discrétement vers Moscou par un avion militaire qui, pour éviter l’espace aérien turc, a dû passer par l’Irak et l’Iran. Sa famille se trouvait déjà à Moscou elle dispose de nombreux appartements de luxe et bénéficie désormais de l’asile politique accordé par le président russe Poutine.
On savait que le régime syrien était vermoulu, gangréné par la corruption généralisée, honni par l’immense majorité d’une population appauvrie par 14 années de guerre dévastatrice mais les observateurs les mieux informés ne s’attendaient pas à un effondrement aussi rapide et brutal. Les parrains étrangers du régime, la Russie et l’Iran, préoccupés par leurs propres problèmes n’ont pas répondu aux appels au secours. Très affaibli par sa confrontation avec Israël et par la contestation à l’intérieur, l’Iran, appris la chute d’Alep où l’armée syrienne ne s’est pas battue, a choisi de sauver les meubles en évacuant d’urgence son personnel diplomatique et ses milices. Quant à la Russie, dont l’aviation a bombardé les positions rebelles aux premiers jours de leur offensive, elle a opté finalement pour la non-intervention conformément à un accord qui aurait été conclu avec la Turquie lui garantissait la sauvegarde de ses intérêts, notamment de ses bases en Syrie. D’autant qu’une bonne partie des effectifs militaires russes en Syrie avaient déjà été transférés vers le front ukrainien. Le Hezbollah libanais, dont les combattants avaient joué un rôle de premier plan pour la défense du régime syrien , avait retiré ses forces pour faire face à l’offensive israélienne. Il ne restait plus que l’armée syrienne. Mal équipée, très mal payée, démotivée, désorganisée par la corruption, elle ne s’est pas battue et a déserté ses positions les unes après les autres.
L’offensive des rebelles coalisés autour de Hayat Tahrir al-Cham (HTC), organisation pour la libération du Levant, semble s’être minutieusement préparée de longue date, en tous cas bien avant l’été. La coordination et la planification ont été élaborées avec l’aide de l’armée et des services de renseignements turcs (MIT). Ankara a fourni des armes et des équipements nécessaires, y compris de drones à cette vaste opération programmée dans un premier temps pour le mois d’octobre. Le président turc qui avait encore quelques espoirs de normalisation de ses relations avec Damas par l’intermédiaire de Moscou est intervenu pour la retarder.
Bachar al-Assad, estimant son régime consolidé grâce à sa réadmission à la Ligue arabe et la normalisation avec les pétro-monarchies, notamment les Émirats-arabes unis, a conditionné toute rencontre avec Erdogan au préalable du retrait des troupes turques des territoires syriens qu’elles occupent. Préalable inacceptable pour Ankara qui a alors donné, mi-novembre son feu vert à l’offensive des rebelles. Le moment opportun a été le lendemain de l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah libanais.
Parrain discret mais décisif de l’offensive, le président turc n’a revendiqué le rôle de la Turquie que le 7 décembre, la veille de la chute de Damas, dans un discours prononcé à Gaziantep, ville frontalière avec la Syrie, en souhaitant que tout se passe dans le calme. Le même jour, son ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan se trouvait à Doha où il intervenait dans un débat avec ses collègues russe et iranien. Il a affirmé plus tard avoir convaincu ces derniers de ne pas intervenir en faveur d’un régime condamné et promis qu’en contrepartie leurs intérêts seraient préservés.
Force principale et structurante de la coalition victorieuse des forces rebelles, le HTC s’est emparé des principaux leviers du pouvoir, un pouvoir qui, symboliquement lui a été transmis par le Premier ministre sortant. Son chef, Abou Mohammed al-Joulani, 40 ans, a célébré la victoire dans l’emblématique Mosquée des Omeyyades de Damas tout comme son ancienne idole Al-Baghdadi avait célébré la prise de Mossoul par l’État islamique, dans la vieille mosquée de cette ville. Dans les jours qui ont suivi la population a été appelée à descendre dans le rues pour fêter sa libération. Al Joulani est devenu ainsi, par légitimité révolutionnaire, le chef d’État de fait de la Syrie pour une période de transition de trois mois.
Le HTC est l’avatar de l’ex-Front Al-Nosra, branche syrienne d’al Qaida et il figure à ce titre sur la liste des organisations terroristes des pays occidentaux. Son chef al-Joulani a lutté dans les rangs d’al Qaida contre les Américains, mais aussi contre la population chiite en Irak où il a été arrêté et purgé cinq ans de prison. Il a ensuite rejoint les rangs de Daech, avant de créer avec quelques autres djihadistes syriens et étrangers le Front al-Nosra, branche syrienne d’al Qaida. Sur les conseils insistants des services turcs et afin de bénéficier de sa part de l’aide humanitaire et militaire transitant par la Turquie, il a rebaptisé son organisation en HTC et annoncé renoncer au djihad international. Peu convaincu par cette mue opportuniste les Etats-Unis ont mis un prix de 12 millions de dollars sur la tête de ce chef « terroriste » par ailleurs partenaire de longue date de leurs alliés turcs et gouverneur de fait de la province rebelle d’Idlib dirigé par le HTC où nombre de djihadistes de Daech, y compris ses chefs, ont pu trouver refuge. Cette province a pu survivre grâce à l’aide internationale, notamment européenne, transitant par la Turquie. L’armée turque y dispose de nombreuses bases et coopère d’une manière routinière avec les dirigeants du HTC.
Ces dirigeants de l’administration du HTC à Idlib sont désormais promus ministres du nouveau gouvernement syrien qui ne compte aucune femme ni le moindre représentant de la diversité ethno-religieuse syrienne. Le chef militaire du HTC est devenu ministre de la Défense, le gouverneur d’Idlib le Premier ministre, le directeur des relations avec les ONG, ministre des Affaires étrangères. Les services turcs et une agence de communication britannique s’emploient à « polir » l’image de ce nouveau pouvoir islamiste et de son chef. Celui-ci porte désormais costume et cravate, reçoit les dirigeants et diplomates étrangers à qui il promet que la nouvelle Syrie sera inclusive et protégera ses minorités, notamment les chrétiens.
L’islamisme « révolutionnaire » dont se réclame le nouveau pouvoir sera probablement tolérant vis-à-vis de ce qui reste de la communauté chrétienne éparpillée entre plusieurs villes du pays en assurant une certaine liberté de culte sans toutefois autoriser les églises à sonner les cloches comme c’est le cas dans la province d’Idlib. On ignore ses intentions envers la minorité alaouite dont était issu le clan d’al-Assad. Le statut des femmes sous ce futur régime islamique suscite également de vives inquiétudes car au-delà des déclarations rassurantes on ne sait pas avec quelle vigueur sera appliquée la charia, la loi islamique dont se réclame le nouveau pouvoir et dont la pratique dans la province d’Idlib au cours des derniers années a de quoi inquiéter les femmes modernes, éduquées et laïques des grandes métropoles syriennes qui ont organisé plusieurs manifestations à Damas pour signifier qu’elles ne vont pas renoncer à leurs libertés chèrement acquises (AFP, 24/12).
Quant au sort des Kurdes dans cette nouvelle Syrie, rien n’a encore transpiré des projets de Damas. Lors de la bataille d’Alep, les commandants locaux du HTC et des forces kurdes ont conclu un compromis pour éviter toute confrontation militaire. Les FDS contrôlant les quartiers kurdes de la ville ont pu évacuer vers des territoires sous contrôle de l’administration kurde en contrepartie de l’engagement qu’aucune violence ou mesure corrective ne sera prise envers la population kurde d’Alep, engagement jusqu’ici respecté. Le 31 décembre des discussions directes ont eu lieu à Damas, entre al-Joulani et le commandant en chef des FDS, le général Mazloum Abdi qualifiées de « positives » (voir AFP 31/12) elles prévoient « le règlement par le dialogue » des problèmes militaires, politiques et économiques relatifs à l’intégration future des régions administrées par les Kurdes, soit plus d’un tiers du territoire syrien, dans la nouvelle Syrie. En signe de bonne volonté l’administration kurde a adopté le nouveau drapeau syrien. Cependant les Forces démocratiques syriennes (FDS) à dominante kurde ne s’estiment pas concernées par un accord signé le 24 décembre par les divers groupes armés et milices syriens qui acceptent leur dissolution et leur intégration progressive dans la nouvelle armée syrienne. Les FDS veulent engager un dialogue avec Damas sur la construction d’une nouvelle armée mais n’entendent pas leur dissolution ou l’intégration de leurs combattants sur une base individuelle. Ayant fait leurs, preuves dans la guerre contre Daech, elles veulent servir de modèle à la nouvelle armée syrienne qui devrait être inclusive, laïque, nationale et faisant une large place aux femmes. Les Kurdes veulent aussi un gouvernement décentralisé garantissant aux Kurdes, aux druzes et aux alaouites un large degré d’autonomie, ce que la direction du HTC refuse d’accepter. Un refus dicté par l’idéologie islamo-nationaliste du HTC et par les fortes pressions de son allié turc pour qui la reconnaissance d’un statut d’autonomie pour les Kurdes syriens constituerait une ligne rouge, « une menace existentielle pour la Turquie ».
Profitant du vide de pouvoir et de l’offensive de la coalition des milices rebelles, Ankara a mobilisé ses supplétifs syriens de « l’Armée syrienne libre » contre les territoires sous contrôle kurde. Sous l’effet de surprise et de retournement de certains chefs tribaux arabes achetés par les services turcs, les villes de Tall Rafaat et Manbij, situées à l’ouest de l’Euphrate sont tombées sous contrôle turc. Mais les forces kurdes tiennent bon sur la rive orientale de l’Euphrate et défendent notamment le très stratégique barrage Tichrine qui fournit 40% de l’électricité de la région. Les combats violents entre les FDS et les milices pro-turques ont fait plus de 400 morts dont de nombreux civils et deux journalistes kurdes de Turquie (AFP, 21/12).
L’offensive des milices pro-turques soutenues par l’aviation turque visant à « déloger » les FDS de toutes leurs positions, y compris de l’emblématique ville de Kobané, symbole de la résistance kurde contre Daech, a suscité une vive émotion dans plusieurs capitales occidentales notamment à Washington, Paris et Bonn. Le sénateur républicain Lindsey Graham a appelé le gouvernement américain à « protéger nos alliés kurdes ». Le commandant en chef du CENTOM s’est rendu au Rojava pour exprimer aux Kurdes son soutien. Les effectifs militaires américains ont été portés à 2000 soldats. Des patrouilles militaires américaines ont été dépêchées à Kobané pour rassurer la population kurde locale . Grâce à la médiation américaine une trêve a été conclue le 12 décembre mais elle n’a tenu que quelques jours.
Le 13 décembre lors d’une visite en Jordanie et avant de se rendre à Ankara, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a déclaré que les forces kurdes syriennes sont « essentielles » pour les États-Unis afin d’empêcher la reprise des activités du groupe État islamique. Tout au long du mois l’aviation américaine a effectué plusieurs dizaines de frappes contre les cibles de Daech. La France et l’Allemagne par la voix de leurs ministres des Affaires étrangères ont également demandé à la Turquie de mettre un terme à son offensive contre les forces kurdes par le biais de ses supplétifs syriens. Cependant, en attendant l’arrivée à la Maison Blanche du Donald Trump. Ankara semble décidé de pousser son avantage sur l’échiquier syrien et créer un fait accompli en position de force pour d’éventuelles futures négociations. Réagissant à la proposition turque d’une « aide militaire » (AFP, 15/12), le nouveau leader syrien al-Joulani, qui utilise désormais son vrai nom Mohamad al-Charaa, se dit dans une interview accordée au quotidien nationaliste turc Yenı Şafak, « reconnaissant » et favorable à un accord stratégique avec la Turquie (Le Monde, 23/12). Un tel accord permettrait à la Turquie de donner un vernis de légitimité à son intervention militaire contre les forces kurdes. Ankara souhaite également signer au plus vite un accord avec Damas, à l’instar de celui signé dans des conditions douteuses avec le gouvernement – croupion de Tripoli, pour la délimitation des zones maritimes respectives en Méditerranée orientale faisant la part belle aux Turcs.
Grande gagnante potentielle du changement de régime en Syrie la Turquie pourrait ne pas engranger tous les bénéfices économiques et géopolitiques escomptés. La Syrie est un pays ruiné sous sanction internationale. Elle a besoin de l’aide européenne et des investisseurs du Golfe pour sa reconstruction et la levée éventuelle des sanctions internationales nécessite des. négociations difficiles avec les pays occidentaux, en particulier avec les Etats-Unis qui après une prise de contact fin décembre avec Damas se contentent de suspendre la qualification d’organisation terroriste du HTC et la mise à prix de la tête de son chef et d’autoriser l’aide humanitaire d’urgence. Les pays du Golfe ne souhaitent pas que la Syrie devienne un protectorat turc après avoir été pendant des décennies celui de l’Iran.
Ces incertitudes lourdes qui pèsent sur l’avenir de la Syrie, n’empêchent pas les Syriens de fêter une liberté si longtemps espérée et rêvée, de profiter, malgré les difficultés matérielles, de l’air de liberté du présent. Beaucoup d’entre eux sont à la recherche des quelque 100.000 disparus. Les témoignages sur les terribles geôles du régime alimentent la chronique des media ainsi que les ateliers de fabrication de drogue, notamment du Captagon qui avait fait de la Syrie un narco-État.
Le 30 décembre, le nouveau gouvernement intérimaire qui, en principe, devait durer trois mois, a annoncé que de nouvelles élections ne pourraient être organisées que dans quatre ans.
Un étrange et opaque processus de négociation semble engagé ces derniers mois entre les autorités turques et le chef historique du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), emprisonné depuis 1999 sur l’île d’Imrali de la mer Marmara.
Sa finalité affiché par ce pouvoir c’est d’obtenir d’Abdullah Ocalan une déclaration publique appelant le PKK à mettre un terme à sa guerre de guérilla qui dure depuis 40 ans et qui a fait plus de 50.000 morts, dont plus de 80% des Kurdes. Au cours de ces décennies et dans cadre d’une politique de contre-insurrection massive, l’armée turque a détruit 3400 villages et hameaux kurdes et provoqué le déplacement forcé de 2 à 3 millions de civils kurdes. Plusieurs milliers de militants civiques, des intellectuels, des avocats, des médecins, de syndicalistes, des journalistes kurdes ont été tués par des escadrons de la mort de la gendarmerie (JITEM) et de la police turque dans de « meurtres à auteurs inconnus » les tristement célèbres « faili meçhul ». La justice turque, si prompte à juger et envoyer en prison pour « propagande terroriste » ou « liens avec une organisation terroriste » les opposants kurdes, y compris des maires et députés élus, n’a pas cherché à élucider ces meurtres.
Le nouveau « paradigme » consisterait à tourner la page, annoncer la fin de la lutte armée du PKK et « la réconciliation entre les peuples frères turc et kurde ».
S’agit-il d’une négociation impliquant une amnistie des prisonniers politique et des combattants du PKK ? Y aura-t-il une reconnaissance, à défaut d’un statut d’autonomie pour la région kurde, de quelques droits culturels et linguistiques pour les 26 millions de Kurdes de Turquie ? (Selon l’estimation récente du leader du Parti républicain du peuple (CHP), kémaliste). Ou d’une simple capitulation ou d’auto-dissolution du PKK à l’appel de son fondateur qui si tout se passe bien, serait alors libéré et assigné à résidence ?
Pour l’heure, on ne dispose d’aucune indication fiable. Ce qu’on sait c’est qu’après dix années d’isolement et d’interdiction de toutes visites de ses avocats et des membres de sa famille, en octobre son neveu Omer Ocalan a pu rendre visite au prisonnier le plus célèbre de Turquie. Cette visite a été autorisée à la suite d’un appel du leader du Parti d’action nationaliste (MHP), extrême-*droite, Devlet Bahçeli, à inviter Ocalan à venir parler devant le parlement pour annoncer « la dissolution de son organisation terroriste (PKK) pour délivrer enfin la Turquie du fléau du terrorisme qui entrave la paix civile et le développement du pays ». La figure de proue de l’ultra-nationalisme turc qui jusqu’à récemment niait l’existence même du peuple kurde n’a certainement pas lancé une telle initiative sans l’accord et l’encouragement du président turc avec lequel il est allié depuis 2015 au sein d’une coalition électorale et gouvernementale.
Le 28 décembre, deux députés du Parti pro-kurde DEM, Mme Pervin Buldan et M. Sirri Süreyya Önder, ont été autorisés à se rendre sur l’île-prison d’Imrali où ils ont rencontré longuement Abdullah Ocalan. Dans la déclaration publique à la suite de cette visite, ils affirment qu’Ocalan leur a paru « en bonne santé » et « de bonne humeur ». Il a présenté des propositions pour résoudre la question kurde en Turquie, souligné « l’urgence de renforcer l’unité turco-kurde. »
Il s’est dit « déterminé à participer au processus de paix » lancé en Turquie : « J’ai la compétence et la détermination nécessaires pour apporter une contribution positive au nouveau processus lancé par M. Bahçeli et M. Erdogan » a déclaré le chef du PKK qui se dit prêt à assumer sa « responsabilité historique » (AFP 29 décembre). Il a demandé à la délégation qui lui a rendu visite d’aller partager son approche avec l’Etat et tous les partis politiques du pays car « l’heure est à la paix, à la démocratie et à la fraternité pour la Turquie et pour la région ».
Le pouvoir turc, de son côté, ne parle ni de « processus de paix » ni du moindre assouplissement de sa politique de répression contre les militants et élus kurdes en Turquie. A la suite de la chute de la dictature d’Assad en Syrie, il a considérablement accentué ses menaces et ses interventions contre les Kurdes de Syrie et parle de « l’éradication de l’organisation terroriste PYD ». C’est-à-dire des Unités de protection du peuple qui forment l’essentiel des Forces démocratiques syriennes (FDS), alliées de la Coalition internationale contre Daech. Interrogé sur « le nouveau processus de paix » le président turc affirme jour après jour : « soit qu’ils (les combattants du PKK) vont enfouir leurs armes, soit qu’ils vont être ensevelis avec leurs armes par notre héroïque armée ». Un discours on ne peut plus martial et belliqueux qui laisse penser qu’en fait de processus de paix on assiste plutôt à de sombres manœuvres visant en cette période de profonde crise politique et économique à occuper les médias, à détourner l’attention de l’opinion publique et à neutraliser le PKK, qui dans un contexte régional en pleins bouleversements pourrait être tenté de nouer des alliances avec les adversaires et ennemis du pouvoir turc.
En Turquie, le principal parti de l’opposition le CHP, se méfie de ces manœuvres occultes et affirme que le seul lieu de débat légitime sur le règlement de la question kurde est le parlement d’Ankara. L’opinion kurde, échaudée par le naufrage encore inexpliqué du précédent « processus de paix » en 2015 reste septique et partagée. L’Union des communautés du Kurdistan (KCK), une « organisation de masse » proche du PKK salue dans une déclaration la vision et les propositions d’Ocalan. « En tant que mouvement pour la liberté et les peuples, nous déclarons que les vues de notre leader ont valeur de manifeste et seront notre boussole de lutte pour la nouvelle année ». Mais la même KCK dénonce « les crimes perpétrés par la Turquie et les milices à son service dans le nord-est de la Syrie » qui ont forcé plus de 100.000 Kurdes à quitter leurs foyers (…) Les femmes et les enfants ont été délibérément massacrés dans le cadre de pratiques génocidaires visant le peuple kurde.
Le 9 décembre, le parti de l’égalité et de la démocratie (DEM), pro-kurde et deuxième formation de l’opposition parlementaire a, lui-aussi, dénoncé les ingérences du gouvernement turc en Syrie, l’accusant d’aggraver le chaos et de saper les efforts de paix. Son co-président, Tuncer Bakirhan, prenant la parole lors d’une session parlementaire sur le projet de budget 2025, est revenu à la charge en appelant le gouvernement turc à mettre fin à ses politiques agressives envers les Kurdes syriens, à engager un dialogue avec l’administration de Rojava et à adopter des politiques favorisant la coopération plutôt que l’hostilité.
Le PKK, de son côté, affirme que c’est l’échec persistant de l’armée turque dans ses offensives contre la guérilla kurde qui oblige le pouvoir turc à lancer cette nouvelle initiative car il n’y a pas de solution militaire à ce conflit. Il se dit en principe, prêt à suivre les directives de son leader emprisonné.
D’après les observateurs et les médias turcs proches du pouvoir le processus en cours devrait aboutir à un appel solennel d’Ocalan en février 2025. D’ici là, on en saura davantage sur la politique de l’administration Trump envers les Kurdes syriens et envers la Turquie, facteur de première importance.
Une loi intitulée « hijab et chasteté », durcissant considérablement les peines et amendes contre les femmes ne respectant pas le port du voile, a été adoptée le 3 décembre par le parlement iranien, dominé par les conservateurs. Cette nouvelle loi, adoptée définitivement, doit en principe entrer en vigueur le 13 décembre.
Les femmes non voilées, contrevenant à cette nouvelle loi, seront identifiées soit par des caméras de surveillance omniprésentes dans les grandes villes, soit par des personnes de confiance du pouvoir, c'est-à-dire des délateurs. Ces derniers pourront dénoncer les femmes non voilées en envoyant, par exemple, à la police la plaque d'immatriculation de leur voiture ou l'adresse d'un magasin ou d'un restaurant où des femmes ne respectent pas le port du voile. Selon le correspondant à Téhéran de RFI, les chauffeurs de taxi ont également l'obligation de dénoncer les femmes non voilées qui montent dans leur véhicule, faute de quoi ils recevront une amende. Même les étrangers vivant légalement en Iran, comme les réfugiés afghans ou irakiens, sont habilités à dénoncer les femmes non voilées.
Les amendes contre les femmes enfreignant la loi sur la « chasteté » édictée par les mollahs sont particulièrement lourdes. Elles vont de 110 € à plus de 2000 € en cas de récidive, dans un pays où le salaire de base n'est que de 120 €. Si une femme ne peut pas payer les amendes, elle ne pourra ni voyager à l'étranger, ni obtenir un permis de conduire, ni accéder à des documents administratifs. La publication de photos de femmes non voilées sur les réseaux sociaux est également passible d'une lourde amende.
Des peines d'emprisonnement sont aussi prévues pour ceux qui font la propagande en faveur du non-respect du voile ou qui envoient des photos ou vidéos de femmes non voilées aux médias étrangers.
Cette guerre culturelle fanatique contre les femmes, soit la moitié de la société, qui survient à peine deux ans après le puissant mouvement « Femme, Vie, Liberté » a suscité un tollé dans la société civile.
Le nouveau président iranien, Masoud PEZESHKIAN, qui, durant sa campagne électorale, avait promis de « retirer de la rue la police des mœurs » chargée de surveiller le port du voile, a exprimé publiquement des doutes sur « la pertinence » de cette nouvelle loi. Il a déclaré dès le 3 décembre que celle-ci risquait de provoquer des tensions dans la société alors que la situation économique est déjà très difficile.
« Nous ne devons rien faire qui puisse mécontenter la nation », a-t-il ajouté.
Défiant le régime, l'artiste Parastoo AHMADI a chanté le 11 décembre sans voile lors d’un concert qualifié d'« historique » dans le désert, sans public, suscitant une vague d'admiration et d'espoir dans la population (Libération, 12 décembre). Lors de cette performance inédite, elle portait un collier en forme de carte de l'Iran, elle devenue un nouveau symbole de la résistance des femmes iraniennes. Sa vidéo, diffusée en direct sur YouTube, a été visionnée plus d'un million de fois. Arrêtée pendant quelques heures, elle a été libérée (Le Monde, 14 décembre). Un autre chanteur, le rappeur Toomaj SALEHI, arrêté en novembre 2023 et condamné à un an de prison pour son soutien aux manifestations consécutives à la mort de Jîna Mahsa AMINI, a été libéré le 2 décembre après avoir purgé sa peine.
Le 4 décembre, Narges MOHAMMADI, prix Nobel de la Paix 2023, a été libérée temporairement de prison pour raison médicale. Selon son avocat, cette sortie anticipée est prévue pour durer trois semaines. À sa sortie de prison, sur un brancard d'ambulance, tête découverte, elle a entonné le mot d'ordre « Femme, Vie, Liberté » et affirmé qu'elle était déterminée à poursuivre son combat contre le port du voile obligatoire et contre la peine de mort. Elle a pu s’entretenir en visioconférence avec le comité Nobel (AFP, 9 décembre) et avec sa famille réfugiée en France.
Face aux réticences du président, aux réactions vives de la société civile et à la crainte d’une relance du mouvement « Femme, Vie, Liberté », la mise en œuvre de la loi sur la chasteté a été « suspendue » le 19 décembre.
Par ailleurs, l'organisation Hengaw pour les Droits de l'Homme a publié son rapport annuel 2024, documentant des violations généralisées des droits de l'homme en Iran. Le rapport révèle une augmentation alarmante des exécutions, des arrestations arbitraires, des violences systématiques et des abus ciblant les groupes marginalisés.
Exécutions : 901 personnes ont été exécutées, dont 183 Kurdes et 13 pour des activités politiques ou religieuses.
Arrestations arbitraires : 1 235 personnes ont été arrêtées, dont 51 % de Kurdes et 137 femmes parmi les détenus.
Kolbars kurdes : 339 kolbars (porteurs transfrontaliers) ont été tués ou blessés, dont 81 % par les forces armées iraniennes.
Féminicides : 182 femmes ont été assassinées, dont 28 dans le cadre de prétendus « crimes d'honneur », souvent par des proches.
Décès en détention : 22 prisonniers sont morts dans les prisons iraniennes, dont neuf sous la torture, y compris plusieurs prisonniers politiques.
Victimes de mines terrestres : 57 personnes ont été tuées ou blessées à cause de mines terrestres et d'engins explosifs.
En décembre, les autorités iraniennes ont intensifié leur répression contre la communauté kurde à travers le Rojhelat, entraînant de nombreuses arrestations, des peines de prison sévères et des restrictions importantes des droits fondamentaux et du droit à un procès équitable.
À Boukan, plusieurs civils ont été condamnés à des peines de prison pour des infractions politiques présumées. Hajar Soltani a été condamné à six mois de prison pour « propagande contre l'État » après avoir été arrêté sans mandat. Ahmad Hassanzadeh, dont le fils a été tué lors des manifestations « Femme, Vie, Liberté », a été condamné à trois mois pour des accusations similaires. De plus, l'Organisation Hengaw pour les Droits de l'Homme a rapporté que Susan Hasan-zadeh, une militante et enseignante bénévole de langue kurde, a commencé à purger une peine de trois mois à la prison centrale d'Urmia pour « propagande contre l'État ».
Piranshahr a également connu une série de condamnations. Un Kurde, Ayub Damavandi, a été condamné à cinq ans et quinze jours pour « espionnage au profit d'Israël ». Un autre résident, Rahman Qaderi, a écopé de huit mois pour « propagande contre l'État ». En outre, deux hommes de Piranshahr, Salam Soltani et Amir Feqeh, ont été condamnés à cinq ans chacun pour avoir prétendument collaboré avec le Parti Démocratique du Kurdistan Iranien (KDPI). Tous deux ont été arrêtés en mai 2024, privés d'avocat et font face à une autre affaire en cours devant le tribunal révolutionnaire de Mahabad.
À Saqqez et Kamyaran, quatre enseignants kurdes – deux dans chaque ville – ont été arrêtés à quelques semaines d'intervalle. Tandis qu'Abdollah Karim Golan de Saqqez a été libéré sous caution, les trois autres restent en détention sans charges claires. Les arrestations d'éducateurs kurdes ne se limitent pas à ces villes ; à Divandareh, quatre enseignants ont été licenciés et un exilé. Ils avaient auparavant été emprisonnés et condamnés à des peines avec sursis pour des infractions présumées liées à la sécurité et associées à leur appartenance au Parti pour une Vie Libre (PJAK), suite à des raids violents en 2022.
Ailleurs, le militant kurde et instructeur de langue Idris Menbari, de Sanandaj (Senna), a été condamné à deux ans pour avoir formé des groupes jugés perturbateurs pour la sécurité nationale. À la prison d'Evin, la militante kurde Varisheh Moradi reste derrière les barreaux, privée de visites familiales et juridiques depuis plus de sept mois. Elle fait face à une condamnation à mort pour des accusations de « rébellion », a enduré des tortures et a entrepris une grève de la faim pour protester contre l'utilisation de la peine capitale par le régime.
À Abdanan, dans la province d'Ilam, le psychiatre et écrivain kurde Naser Hemmati est accusé de « blasphème contre le Prophète » et de « propagande en soutien à l'État sioniste ». Auparavant emprisonné pour « insulte à Khamenei » et « propagande contre l'État », les ennuis judiciaires d'Hemmati persistent malgré son absence d'activité récente sur les réseaux sociaux.
Sur le plan géopolitique, l'Iran a dû assister, sans pouvoir réagir, à l’effondrement de son « axe de la résistance », construit à grand frais pendant plusieurs décennies pour assurer l’influence régionale de la République islamique. Le pivot de cet axe, le régime syrien d’al-Assad, s'est effondré, laissant place à un pouvoir islamique sunnite pro-turc. Le Hezbollah libanais a été considérablement affaibli par Israël, qui, par ailleurs, a sérieusement amoindri les capacités de défense anti-aérienne de l’Iran. Le Hamas survit à peine dans ses tunnels sous les coups des bombardements israéliens incessants. Même les milices chiites irakiennes ont dû faire profil bas face à la menace de représailles israéliennes.
Par ailleurs, après la chute de la dictature d'Assad en Syrie, les partis kurdes iraniens ont publié des déclarations félicitant le peuple syrien et exprimant l'espoir d'un effondrement éventuel de la République islamique d'Iran. Ils ont souligné que, malgré d'immenses difficultés, le peuple kurde de Syrie a obtenu des avancées significatives qui doivent être protégées. Les partis ont exhorté les forces politiques kurdes au Kurdistan syrien (Rojava) à rester unies, à affronter les défis futurs de manière stratégique et à consolider leurs progrès durement acquis.
Affaibli, voire acculé, le régime iranien semble placer ses espoirs de survie dans son programme nucléaire. Selon Rafael M. GROSSI, directeur de l'Agence internationale de l’énergie atomique, cité par le New York Times du 6 décembre, l’Iran a fait « un bond dramatique » vers la production de combustible nucléaire proche du degré d’utilisation pour une bombe. Sa production d’uranium enrichi à 60 % a quadruplé récemment et continue de s’accélérer. Ces activités nucléaires de l’Iran sont « préoccupantes », affirme R. GROSSI, qui avait dirigé en novembre une mission d’inspection en Iran. Il alerte les États membres de l’AIEA et les appelle à se mobiliser pour arrêter cette course vers la production d’une bombe nucléaire.
Les équipes kurdo-irakiennes chargés de l’exhumation des corps des civils kurdes victimes des campagnes génocidaires du régime de Saddam Hussein ont, mi-décembre, découvert un nouveau charnier près de la localité de Tal al-Shaikhia, dans le sud irakien. Les restes d’une centaine de femmes et d’enfants kurdes ont été découverts dans une fosse commune ont annoncé les responsables
le 26 décembre. Dans une déclaration à l’AFP (26/12), Diaa Karim, chef de l’autorité irakienne chargée des fosses communes évoque ce long travail d’exhumation. « Après avoir enlevé la première couche de terre et que les restes soient apparus clairement, on a découvert qu’ils appartenaient à des femmes et à des enfants vêtus de vêtements kurdes ».
Un grand nombre de victimes « ont été exécutées ici par balles tirées à bout portant dans la tête » précise M. Karim qui ajoute que les opérations pour exhumer tous les corps sont toujours en cours.
Les victimes seraient probablement originaires du district de Kalar de la province de Souleimanieh.
Un autre charnier a été découvert à proximité a indiqué à un correspondant de l’AFP, Dourgham Kamel, qui fait partie de l’autorité chargée de l’exhumation des fosses communes, près de la célèbre prison de Nougrat Salman où ont été martyrisés des milliers de Kurdes et opposants politiques de Saddam Hussein.
Les campagnes génocidaires appelées Anfal (butin) menées par le régime de Saddam Hussein en 1987-1988 ont fait 182.000 morts au Kurdistan. Les victimes, civiles, femmes, enfants, vieillards, déportés dans les déserts du sud irakien, notamment dans la province de Mouthana étaient soit abattues par balles à bout portant soit ensevelies vivantes, « pour économiser des munitions », dans des fosses communes souvent aplanies par des bulldozers. Depuis la chute du régime dictatorial, en 2003, et la pendaison de Saddam Hussein des charniers sont découverts régulièrement par les équipes d’exhumation qui passent au peigne fin ces vastes zones désertiques. L’une des découvertes majeures avait été un charnier contenant les restes de quelque 500 corps des Barzani enlevés et assassinés en 1983 par le régime irakien. Ces restes rapatriés au Kurdistan ont été inhumés dans le Cimetière des martyrs de Barzan. Les restes de 7500 autres Barzani enlevés au cours de cette même rafle de 1983 n’ont toujours pas été trouvés.
Dans le reste de l’actualité du mois au Kurdistan et en Irak, on notera le début des négociations entre les dirigeants du PDK et l’UPK en vue de la formation d’un gouvernement de coalition. Une première réunion s’est tenue à Erbil le 17 décembre pour déblayer le terrain et définir les orientations principales du futur gouvernement. La situation en Syrie a également fait l’objet de débats car elle pourrait impacter la région du Kurdistan qui a une frontière de 100 km avec la Syrie. Cette situation pourrait également avoir un impact sur le mandat de la Coalition internationale contre Daech dont la présence au Kurdistan devrait, en principe, s’achever fin 2026. En attendant, l’administration américaine a reconduit son aide aux peshmergas ainsi qu’à l’armée irakienne.
Malgré la reprise de négociations avec Bagdad et de nouvelles promesses sans lendemain, la question de la reprise de l’exportation du pétrole du Kurdistan n’a toujours pas été réglée. La part du budget revenant au Kurdistan continue d’être versée avec des retards considérables, fragilisant l’économie kurde.
Le ministère des Finances du Gouvernement régional du Kurdistan (GRK) a critiqué le gouvernement fédéral irakien pour ne pas avoir respecté ses obligations financières envers la région du Kurdistan, laissant les employés publics de la région sans salaire depuis trois mois.
Selon le ministère, Bagdad n'a transféré que 10,75 trillions de dinars sur les 11,58 trillions de dinars alloués pour 2024 en vertu de la loi budgétaire. Ce déficit a contraint le GRK à allouer environ 960 milliards de dinars de ses revenus internes pour couvrir les déficits salariaux. Le ministère a accusé Bagdad d'utiliser le prétexte d'une « liquidité insuffisante » pour retenir les paiements, faisant porter le poids de ses problèmes financiers aux employés de la région du Kurdistan.
Le communiqué a également souligné que le gouvernement fédéral n'a alloué aucun fonds pour des projets de développement dans la région du Kurdistan depuis plusieurs années, ce qui aggrave encore la pression sur les ressources internes de la région, qui sont également utilisées pour maintenir des services publics essentiels tels que la santé, l'éducation et les infrastructures.
Le ministère des Finances du GRK a appelé Bagdad à respecter ses obligations légales et constitutionnelles et à résoudre rapidement les différends financiers en cours. Les employés publics de la région du Kurdistan restent impayés depuis trois mois.
A noter que la suspension toujours en cours des exportations de pétrole du Kurdistan, a déjà causé une perte de près de 24 milliards de dollars pour l'Irak et la région du Kurdistan, selon l'Association de l'industrie pétrolière du Kurdistan (APIKUR).