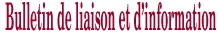Le 29 janvier, un "Congrès de la Victoire" a réuni à Damas les chefs des principales milices arabes sunnites alliées de Hayat Tahrir al-Cham (HTC) pour désigner le leader de ce groupe, Ahmed al-Charaa, comme président par intérim de la République arabe syrienne. Cette décision entérine une situation de fait qui prévalait depuis la prise de Damas, le 8 décembre, par le HTC et ses alliés.
Le chef de guerre al-Joulani retrouvait son véritable nom, Ahmed al-Charaa, et s’installait au palais présidentiel, abandonné par Bachar el-Assad, où il a reçu comme un véritable chef d’État, d’abord les ministres turc et qatari des Affaires étrangères, ses parrains et soutiens de longue date, puis des émissaires arabes et occidentaux. Même les États-Unis, qui avaient pourtant mis un prix de 10 millions de dollars sur la tête de ce chef jihadiste ayant combattu l’armée américaine, ont "suspendu" leur récompense et envoyé des émissaires pour évaluer la situation humanitaire sur place ainsi que les perspectives d’une éventuelle coopération.
Les chefs de la diplomatie française et allemande ont rencontré, le 3 janvier, le nouveau maître de Damas pour favoriser une transition pacifique et exiger un gouvernement au service des Syriens et de la stabilité régionale. Dans un message sur X, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, souligne « l’importance d’une gouvernance démocratique où chacune des composantes de la nation syrienne serait pleinement reconnue et respectée ». Son homologue allemande, Annalena Baerbock, a déclaré : "Nous continuerons à juger le HTC sur ses actes, en dépit de notre scepticisme."
Elle a exhorté les autorités de transition à « ne pas compromettre le processus politique par des délais excessivement longs jusqu’aux élections, ni par des mesures visant à islamiser la justice ou le système éducatif ».
Les deux ministres ont également rencontré les patriarches chrétiens et des représentants de la société civile syrienne, qui ont exprimé « le souhait de voir élaborer une constitution garantissant des droits égaux pour tous les citoyens dans le respect de leur diversité ».
En réponse à ces attentes, Ahmed al-Charaa a assuré aux deux ministres européens qu’une conférence de dialogue national serait organisée par un comité préparatoire indépendant, au sein duquel "la diversité de la Syrie serait représentée, y compris les femmes."
Lors de cette rencontre, le ministre français a également exprimé « le souhait qu’une solution politique soit trouvée avec les alliés de la France, que sont les Kurdes, afin qu’ils soient pleinement intégrés dans le processus politique qui s’engage aujourd’hui ».
La ministre allemande, pour sa part, a exhorté les nouvelles autorités de Damas à éviter "les actes de vengeance contre des groupes entiers de population" et à mettre de côté "l’extrémisme et les groupes radicaux. Cela doit être notre objectif commun. Et cela est également dans notre propre intérêt : la sécurité en Europe et en Allemagne y est étroitement liée."
La France envisage une "levée progressive et conditionnée" des sanctions visant la Syrie et prépare de façon graduelle les modalités de son retour dans le pays (Le Monde, 4 janvier).
Les nouveaux dirigeants syriens, habillés et coachés par les services turcs ainsi que par une agence de communication britannique, tiennent des discours modérés et rassurants à leurs interlocuteurs occidentaux afin d’obtenir, dès que possible, la levée des sanctions et l’octroi d’une aide humanitaire massive dont la population syrienne éprouvée a tant besoin.
Toujours sur les conseils d’Ankara, qui n’a pas les moyens d’apporter une aide substantielle à la reconstruction de la Syrie, ils courtisent les pétromonarchies du Golfe afin d’obtenir leur soutien. Le nouveau ministre syrien des Affaires étrangères a d’ailleurs choisi l’Arabie saoudite pour son premier voyage à l’étranger, avant d’entamer une tournée des autres États arabes : le Qatar, les Émirats arabes unis et la Jordanie.
À la suite de ce voyage, l’Arabie saoudite a mis en place un pont aérien vers la Syrie, permettant de livrer nourriture, abris et fournitures médicales. Le royaume a également proposé de former et d’équiper la police civile syrienne ainsi que de remplacer l’approvisionnement en pétrole iranien afin d’aider à soulager la crise énergétique du pays.
Le Qatar et la Jordanie ont également envoyé une aide humanitaire d’urgence. Ce faisant, ils espèrent réduire les flux de drogue et de combattants islamistes radicaux à la frontière syrienne et contrer l’influence turque, afin d’éviter que la Syrie ne devienne un protectorat turc après avoir été, pendant des décennies, une alliée de l’Iran.
Les Émirats arabes unis, qui ont bien accueilli la délégation syrienne, ne se précipitent pas pour aider un gouvernement dirigé par le HTC. Cependant, le Conseil de coopération du Golfe, dominé par l’Arabie saoudite, a l’intention d’offrir une aide technique pour reconstruire les routes, les écoles, les hôpitaux et les logements en Syrie.
Le 7 janvier, Qatar Airways est devenue la première compagnie aérienne internationale à reprendre les vols commerciaux vers Damas, suivie peu après par Turkish Airlines.
Le 27 janvier, l’Union européenne a décidé une suspension graduelle des sanctions contre la Syrie. Le ministre syrien des Affaires étrangères a salué sur X "une décision positive" qui "aura un impact favorable sur l’ensemble des aspects du quotidien du peuple syrien." (Le Monde, 27 janvier).
Cependant, les discours modérés et inclusifs des nouveaux dirigeants syriens ne se traduisent pas dans leur pratique de gouvernance. Le gouvernement de transition, annoncé le 9 janvier, est composé de proches, d’anciens djihadistes et de technocrates islamistes conservateurs qui gouvernaient déjà la province d’Idlib (Le Monde, 9 janvier).
Aucune femme, aucun chrétien, aucun Kurde, ni aucun représentant de la société civile ou d’une autre force politique n’y figure. De même, le "Congrès de la Victoire" du 27 janvier où ont participé des chefs de milices figurant sur les listes de terrorisme des pays occidentaux ou recherchés pour crimes de guerre, comme Ahmad Ihsan Fayyad al-Hayes (Abu Hatim Shaqra), l’assassin de la secrétaire générale du Parti de la Syrie future, Mme. Hevrin Khalaf, dont plusieurs rues et places portent le nom en France. Un autre criminel notoire, Mohammed al-Jassim, dit Abou Amsha, coupable de nombreux crimes dans le canton d’Afrin, paradait lors de ce congrès aux côtés de plusieurs djihadistes étrangers promus généraux.
Dans un communiqué de presse, l’Administration du Nord-Est de la Syrie conteste la légitimité de ce congrès et de l’élection d’Ahmed al-Charaa à la présidence. « La victoire appartient à toutes les composantes de la société syrienne qui attendent la convocation d’un Congrés national inclusif chargé des préparatifs d’une nouvelle Constitution et d’éléctions parlementaires libres » souligne le communiqué.
Dans cet esprit des dizaines d’intellectuels syriens de renom ont lancé le 3 janvier une petition en ligne pour « réclamer la restauration de toutes les libertés et l’éléction d’une assamblée constituante » (AFP, 31 janvier). La minorité druze cherche aussi sa place dans cette Syrie nouvelle où les alaouites se sentent, eux, particulierement ménacés.
Le processus politique de transition s’avère donc très complexe. Ankara pèse de tout son poids pour, sinon exclure, du moins marginaliser les Kurdes syriens et leur refuser tout statut d’autonomie, qu’elle considère comme une menace existentielle pour la Turquie.
Les milices pro-turques de la soi-disant Armée syrienne libre ont poursuivi leurs attaques contre les positions des Forces démocratiques syriennes (FDS) autour du barrage stratégique de Tichrine, en dépit des efforts de médiation des États-Unis et de la France. Les appels au cessez-le-feu dans toute la Syrie sont ignorés. L’aviation turque bombarde régulièrement les positions des FDS ainsi que les manifestations pacifiques des civils opposés à la guerre.
Le 18 janvier, un bombardement turc a tué cinq manifestants civils, dont le célèbre comédien kurde Bavé Teyar, et blessé quinze autres (Rudaw, 19 janvier). Les combats, ont depuis décembre dernier, fait plus de 800 morts.
Dans le chaos syrien, les combattants kurdes sont dépourvus de moyens de défense anti- aérienne sont ainsi abandonnés à la vindicte turque, un abandon qui suscite de réactions dans les opinions publiques en Europe et aux Etats-Unis sans parler des Kurdes de Turquie et d'Irak qui sont très inquiets pour l'avenir de Rojava (Le Monde, 15 janvier).
Dans une tribune publiée dans le Figaro du 22 janvier, l'ancien président français François Hollande et l'ancien Premier Ministre de droite Jean-Pierre Raffarin écrivent : « La France a le devoir de protéger les Kurdes de Syrie ». Ils proposent notamment que la France prenne plusieurs initiatives : « Renforcer la présence française, actuellement modeste, au Nord-Est de la Syrie pour dissuader la Turquie d'une incursion militaire. Envoyer une aide humanitaire d'urgence en zone kurde pour les déplacés. Proposer une résolution au Conseil de sécurité de L'ONU créant une mission d'observation des frontières entre le Nord-Est syrien et la Turquie pour mettre fin aux agressions quotidiennes. Soutenir financièrement et matériellement les efforts des Kurdes qui assument le rôle de gardien des individus et de familles qui ont servi l'Etat islamique. Leur fuite nous exposerait ici, en Europe".
Une aide humanitaire d'urgence est d'autant plus nécessaire que « le gel des aides accordées par l'agence USAID menace la sécurité dans les camps, où sont détenus les personnes de Daech » avertit le New York Times (30 janvier).
Le 31 janvier, le président Macron a appelé le président du Kurdistan Nechirvan Barzani pour s'informer des derniers développements en Irak et en Syrie. Il lui a confirmé que "La France continuera à soutenir les Forces démocratiques syriennes qui mènent la guerre contre Daech, dans le respect de la souveraineté de la Syrie. Les Kurdes de Syrie doivent être complétement intégrés dans le dialogue » a ajouté le président Macron selon le communique de l'Elysée (voir aussi Rudaw, 31 janvier).
La défense de Rojava et de ses acquis des Kurdes Syriens est devenue une cause nationale pour tous les Kurdes. Le leader kurde Massoud Barzani a envoyé un émissaire qui a rencontré le général Mazloum Abdi, commandant en chef des FDS le 13 janvier et l'a invité à Erbil. La rencontre entre Massoud Barzani et Mazloum Abdi, le 16 janvier, très médiatisée, a été chaleureuse et constitue « un moment fort d'unité nationale kurde » selon les deux parties. Barzani a assuré le général Mazloum Abdi de son soutien et de celui du Kurdistan irakien. C'est une note d'espoir dans une période difficile pour le peuple kurde.
Arrivé au pouvoir pour réaliser son ambitieux projet de "réislamisation" de la société turque, le parti islamo-nationaliste du président Erdogan peine à récolter les résultats espérés. Certes, il a investi des sommes colossales dans la construction de nouvelles mosquées un peu partout dans le pays, mais celles-ci sont, pour la plupart, peu fréquentées, souvent à moitié vides, même lors de la prière du vendredi. Même l’emblématique basilique Sainte-Sophie, transformée en mosquée par Erdogan, voit sa fréquentation militante baisser mois après mois.
Le revers le plus grave pour le régime est l'effondrement de la natalité. Malgré les encouragements diffusés sur les chaînes de télévision gouvernementales et dans les mosquées, le taux de croissance démographique est passé de 2,53 % en 2015 à 0,23 % en 2024. Plus alarmant encore pour Ankara, entre 2001 et 2024, le nombre d'enfants par femme est passé de 2,38 à 1,5, bien en deçà du taux de 2,05 nécessaire au renouvellement des générations. Si le phénomène semble global, la chute de la courbe démographique de la Turquie a été "particulièrement rapide, comme en Italie et au Japon" (Le Monde, 24 janvier).
Les exhortations du président, répétées régulièrement depuis 2018, à faire plus d’enfants n’ont guère été suivies d'effet. Selon lui : "Un seul enfant, c’est étrange. Deux enfants, c’est la compétition. Trois enfants, c’est l’équilibre. Quatre enfants, c’est l’abondance. Cinq enfants, c’est la volonté divine !"
Dans la pratique, les familles kurdes semblent être les seules à suivre ces préceptes, car la démographie reste toujours dynamique dans les provinces kurdes. Les Kurdes, évalués récemment à 26 millions par le chef du Parti républicain du peuple Özgür Özel, pourraient, si les tendances actuelles se maintiennent, devenir majoritaires dans quelques décennies – ce qui alerte le régime turc, qui intensifie sa politique d'assimilation forcée, doublée d'une répression féroce contre ceux qui s'y opposent.
Le 13 janvier, le président turc a annoncé que 2024 serait "l'année de la famille". Il crée un Haut conseil des politiques démographiques et un Institut de la famille. Les mères pourront recevoir un salaire mensuel compris entre 1 500 LT (40 €) et 5 000 LT (132 €) pour la naissance du premier, deuxième et troisième enfant après le 1er janvier. Les jeunes mariés âgés de 18 à 29 ans et ayant des revenus modestes pourront bénéficier d'un crédit de 150 000 LT (4 000 €).
Après avoir affirmé que le XXIe siècle serait "un siècle turc", alors que son homologue indien Modi promet que ce sera "un siècle indien", voici donc l’année 2025 appelée à réaliser un miracle : l'inversion de la courbe démographique.
La baisse de la natalité serait, selon le président Erdogan, due à "l'évolution des moeurs" qui nuirait à la famille. Il fustige les films et les séries télévisées qui promeuvent l'idéologie LGBTQ+, accusée de tous les maux du pays. Or, cette communauté est peu visible en Turquie, et ses défilés de la fierté sont interdits depuis 2015.
Pour les sociologues, ce sont les conditions socio-économiques, la cherté de la vie, les salaires de misère et les loyers élevés qui empêchent les jeunes de fonder une famille et d’élever des enfants. L'hyperinflation fait des ravages. Selon les chiffres officiels, elle s'est élevée à 44,9 % sur un an, mais d'après les économistes indépendants du Groupe de recherche sur l'inflation, elle a atteint 83,4 % sur les douze derniers mois (Le Monde, 30 janvier).
Dans un pays où plus de 60 % de la population active est payée au SMIC, celui-ci a été fixé à 22 104 LT (605 €). La livre turque, qui, lors de son introduction en 2005, valait 50 centimes d’euro, est aujourd’hui tombée à un taux de 1 euro pour plus de 38 LT.
Dans un sondage publié début janvier par l’hebdomadaire Gazete Oksijen, 47 % des 18-24 ans et 39 % des 25-49 ans estiment que l'état actuel du pays ne permet pas d'élever correctement un enfant. Le taux de suicide des jeunes bat des records.
Pour détourner l'attention du public de la crise économique et sociale, le président turc multiplie les déclarations tonitruantes contre Israël, contre "les terroristes kurdes de Syrie", et se pose en leader global défenseur des Palestiniens et des musulmans opprimés, sauf les Kurdes évidemment.
Parallèlement, il poursuit la répression contre tous ses opposants et les voix critiquant sa politique ou le système judiciaire au service du pouvoir.
L'ONG Human Rights Watch a publié, le 16 janvier, son rapport annuel dénonçant "le bilan répressif" de la Turquie en matière de droits humains. "Le gouvernement turc doit cesser d'engager des poursuites pénales fabriquées, d'émettre des ordres de détention contre ses détracteurs, de destituer des élus locaux et doit se conformer aux arrêts contraignants de la Cour européenne des droits de l'homme", affirme un communiqué de l'ONG (AFP, 16 janvier).
Celle-ci dénonce également de "graves violations des droits humains commises par l'Armée nationale syrienne (ANS) dans les zones du nord de la Syrie sous contrôle effectif de la Turquie".
Elle rappelle que depuis les élections locales de mars 2024, sept maires élus du DEM (Parti de l'égalité des peuples et de la démocratie), principal parti pro-kurde de Turquie, ainsi que deux élus du CHP (Parti républicain du peuple), ont été arrêtés et destitués.
Le 13 janvier, le ministre de l'Intérieur turc a annoncé l'arrestation d’un autre maire kurde, celui du district d'Akdeniz, dans la province côtière de Mersin, et de quatre autres élus pour "liens avec une organisation terroriste". Les cinq élus ont été destitués sans aucune forme de procès.
Le 15 janvier, le parquet général d'Istanbul a lancé une procédure de destitution du barreau d'Istanbul, de son président et de son conseil de l'ordre, pour "propagande terroriste". La justice turque reproche au barreau d'Istanbul d'avoir réclamé une enquête sur la mort, fin décembre en Syrie, de deux journalistes kurdes de Turquie, visés par un drone turc, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (AFP, 15 janvier).
En janvier, l'étrange "processus de paix" s’est poursuivi. Une délégation de députés kurdes du DEM a rencontré à deux reprises, le 2 janvier et le 22 janvier, Abdullah Öcalan dans sa prison de l'île d'İmralı. Elle a aussi rendu visite à l’ex-président, Selahattin Demirtaş, incarcéré depuis 2016 à Edirne, en Thrace, pour "délit d'opinion". Un appel à la paix du leader de PKK est annoncé pour mi-février.
Le Parlement irakien a adopté le 21 janvier un amendement à la loi sur le statut personnel qui, s'il devenait définitif, ouvrirait la voie aux mariages des petites filles dès l'âge de 9 ans.
Ce texte, proposé par les élus chiites conservateurs depuis des mois, a finalement été approuvé dans un hémicycle à moitié vide. Il autorise les Irakiens chiites en matière d'affaires familiales, dont le mariage, l'héritage, le divorce et la garde d'enfants, à suivre les préceptes de leur communauté religieuse plutôt que les règles de droit de l'État. Il donne ainsi au clergé chiite un droit de regard sur la gestion des affaires familiales et pourrait encourager les mariages précoces.
En effet, l'école juridique jafarite, suivie par les conservateurs chiites irakiens et iraniens, autorise les mariages des filles pubères, à partir de l'âge de 9 ans, car le Prophète Mahomet aurait épousé sa dernière femme Aïcha à cet âge-là.
Dans la pratique, les mariages d'enfants sont en constante augmentation depuis une vingtaine d'années. Selon l'UNICEF, cité par Le Monde du 25 janvier, 28 % des Irakiennes sont mariées avant l'âge de 18 ans et 22 % des unions non enregistrées, célébrées par des autorités religieuses, concernent des filles âgées de moins de 14 ans, en violation de la loi en vigueur, fixant l'âge légal du mariage à 18 ans.
Le texte qui vient d’être adopté par le Parlement irakien vise à légaliser cette pratique qui permet aux hommes, souvent d'âge mûr, d'épouser des petites filles ou des adolescentes, car aucune femme majeure n'épouse un enfant de 9 ans ou un adolescent.
L'État s'enorgueillissait jusqu'à récemment de sa loi sur le statut personnel adopté en 1959 par le régime révolutionnaire du général kurdo-arabe Abdel Karim Kassem qui a, le 14 juillet 1958, renversé la monarchie sous influence britannique et instauré une république proclamant la fraternité des peuples arabe et kurde. Cette loi avant-gardiste pour son époque au Moyen-Orient a transféré la compétence en matière d'affaires familiales des autorités religieuses à l'État et à son système judiciaire. Elle fixait l'âge légal du mariage à 18 ans et restreignait la pratique de la polygamie.
Cet acquis historique est désormais remis en cause par le nouveau texte adopté qui, s'il devenait définitif, contreviendrait aussi à plusieurs conventions internationales signées par l'Irak, notamment celle relative aux droits de l'enfant, ratifiée en 1994, et celle sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ratifiée en 1986.
Les autorités religieuses chiites ont désormais quatre mois pour édicter des obligations s'imposant aux membres de leur communauté en matière de statut personnel. Leur texte sera ensuite soumis au vote des parlementaires.
Si ces derniers l'adoptent, il sera alors soumis à la signature du président de la République Kath Rashid, un Kurde libéral réputé féministe, pour devenir définitif. L'un de ses prédécesseurs, et son beau-frère, Jalal Talabani, opposé à la peine de mort, avait refusé de signer l'ordre d'exécution de son pire ennemi, Saddam Hussein, mais le gouvernement à dominante chiite, désireux d'une vengeance rapide, avait profité de son absence de Bagdad pour faire signer l'ordre par son vice-président chiite. Et Saddam a été exécuté dans la précipitation avant même de faire face à ses autres procès pour crimes contre l'humanité comme sa campagne génocidaire d'Anfal contre les Kurdes.
Les organisations féministes, de nombreuses ONG, des intellectuels et bon nombre de députés de tous bords sont debout contre ce texte d'un autre âge, accusé de légaliser la pédophilie, et luttent pour empêcher son adoption définitive.
Cette nouvelle loi, si elle finissait par être adoptée définitivement, ne s'appliquerait pas au Kurdistan autonome, qui a sa propre législation interdisant formellement les mariages précoces.
Par ailleurs, le 21 janvier, le Parlement irakien a aussi adopté une loi amnistiant les Arabes sunnites emprisonnés pour divers délits et crimes, y compris participation à des activités rebelles, à l'exception des condamnés pour crimes de sang.
Une autre loi adoptée le même jour permet aux Kurdes et Turkmènes de la province de Kirkouk, expropriés lors de la politique d'arabisation menée sous la dictature de Saddam Hussein, de recouvrer leurs terres et leurs biens.
Cette loi intervient quelques jours après la signature par Bagdad avec la compagnie britannique British Petroleum d'un accord sur l'exploitation des champs pétroliers de Kirkouk.
Le Gouvernement régional du Kurdistan (GRK) a fermement dénoncé cet accord accusant le gouvernement fédéral de violer la Constitution irakienne et de porter atteinte aux droits du peuple kurde. Dans un communiqué publié le 12 janvier 2025, le GRK a réaffirmé son engagement à défendre son autorité constitutionnelle et à protéger les droits de la Région du Kurdistan, y compris ceux de Kirkouk.
Au cœur du différend se trouve l'article 140 de la Constitution fédérale irakienne de 2005, qui impose au gouvernement fédéral d'organiser un référendum à Kirkouk et dans d'autres territoires disputés afin de déterminer leur statut administratif. Ce référendum devait initialement avoir lieu avant le 31 décembre 2007. Cependant, les gouvernements successifs de Bagdad ont omis de remplir cette obligation, laissant le statut de ces territoires en suspens depuis près de deux décennies.
Le communiqué du GRK indique que Bagdad exploite désormais unilatéralement les ressources pétrolières et gazières de Kirkouk, en ignorant les dispositions constitutionnelles. Selon l'article 112 de la Constitution irakienne, Bagdad est tenu de gérer conjointement les champs pétroliers existants, comme ceux de Kirkouk, avec la Région du Kurdistan et de conclure des accords de partage des revenus. De plus, les articles 110 et 115 accordent au GRK l'autorité exclusive pour gérer les nouveaux champs pétroliers et gaziers.
Dans une évolution connexe, le porte-parole du GRK a également publié une déclaration contre les actions unilatérales du gouvernement fédéral visant à amender la loi de finances fédérale. Le GRK a affirmé que, malgré de nombreuses réunions et deux lectures au Parlement fédéral, le vote final sur l’amendement n’a pas eu lieu.
Selon le porte-parole, une nouvelle proposition a été soumise de manière inattendue par le représentant du gouvernement fédéral au Parlement fédéral, sans consultation du GRK ni approbation du Conseil des ministres fédéral. Cette action unilatérale, selon le communiqué du GRK, contredit directement une décision antérieure du Conseil des ministres fédéral visant à amender la loi de finances afin de faciliter la reprise des exportations de pétrole de la Région du Kurdistan. Les exportations de pétrole du Kurdistan sont suspendues depuis près de deux ans, coûtant à Bagdad plus de 20 milliards de dollars et impactant sévèrement l’économie du Kurdistan.
L'accord avec British Petrolium s'inscrit dans le cadre d'une coopération bilatérale irako-britannique plus vaste annoncée lors de la visite à Londres du Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani le 14 janvier. Au cours de cette visite de trois jours, le Premier ministre a été reçu par le roi Charles III et par son homologue britannique Keir Starmer. Plusieurs protocoles d'entente et un accord de partenariat stratégique ont été signés à cette occasion.
"C'est une nouvelle ère dans la coopération entre le Royaume-Uni et l'Irak qui apportera des avantages mutuels, du commerce à la défense", s'est félicité le Premier ministre britannique (AFP, 14 janvier).
Les deux dirigeants ont annoncé des accords commerciaux à hauteur de 12,3 milliards de livres sterling (plus de 14 milliards d'euros). Les échanges commerciaux vont être multipliés par dix par rapport à l'année dernière entre les deux pays, selon Keir Starmer.
L'Irak entretient avec son ancienne puissance coloniale des rapports ambivalents. Longtemps décrié, le Royaume-Uni est revenu en grâce aux yeux de la majorité chiite au pouvoir en raison de sa participation à « la guerre de libération de l'Irak » contre la dictature de Saddam Hussein, dont les chiites ont également beaucoup souffert.
L'engagement des troupes britanniques au sein de la Coalition internationale contre Daech est également apprécié. Le mandat de celle-ci s'achèvera en septembre 2025 en Irak et à partir de septembre 2026 au Kurdistan.
L'incertitude sur la politique de l'administration Trump envers la région incite le gouvernement irakien à équilibrer ses relations avec l'Iran par un accord stratégique avec une puissance occidentale afin de bénéficier des technologies modernes, y compris dans l’armement.
Un accord sur les retours de migrants dévoilé en novembre a été entériné dans le but de "soutenir la lutte contre l'immigration illégale". Cet accord garantit que "ceux qui n'ont pas le droit d'être au Royaume-Uni pourront être renvoyés rapidement en Irak", selon un communiqué du bureau du Premier ministre britannique. Londres évoque des exportations d'équipements d'une valeur de 66,5 millions de livres (plus de 79 millions d'euros) pour "renforcer les frontières de l'Irak et démanteler les gangs de passeurs".
En janvier, les négociations pour la formation d'un gouvernement de coalition au Kurdistan se sont poursuivies sans résultat. Les discussions entre Bagdad et Erbil se sont déroulées dans un "climat positif et constructif", mais Bagdad continue de retarder régulièrement le versement de la dotation financière du Kurdistan.
Cependant, le Kurdistan fait preuve de résilience et multiplie ses initiatives diplomatiques avec les pays voisins, les pétromonarchies du Golfe et, bien sûr, avec ses partenaires et alliés occidentaux. Ainsi, le Premier ministre du Kurdistan, Masrour Barzani, a inauguré le 20 janvier une "Maison du Kurdistan" (Kurdistan House) en compagnie du président de la République irakienne, Latif RASHID, du Président de l’Institut kurde de Paris, Kendal NEZAN, et de nombreux invités et hommes d'affaires kurdes, venus participer à ce forum économique prestigieux pour faire connaître le Kurdistan et nouer des relations avec les décideurs politiques et économiques.
La chute du régime syrien bouleverse la stratégie régionale du régime des ayatollahs et diminue considérablement sa capacité de nuisance.
Ce constat, fait par des observateurs et analystes au lendemain de la chute de la dynastie des al-Assad, semble aussi partagé par certains hauts responsables de la République islamique. "Nous avons subi une défaite sévère", affirme sans détour le général Esbati lors d’une intervention devant des militaires rassemblés à la mosquée Vali-e-Asr de Téhéran, le 31 décembre, dans un débat sur le thème "Répondre aux questions sur l’effondrement de la Syrie".
Un enregistrement de cette intervention a été diffusé sur les réseaux sociaux, notamment par le site Abid Media, basé à Genève, le 6 janvier. Le générale déclare d’emblée : « Je ne considère pas que perdre la Syrie soit quelque chose dont on peut être fiers. Nous avons été défaits, et très sévèrement défaits. Nous avons pris un très grand coup, et ça a été extrêmement difficile».
Ce général, qui a supervisé les opérations militaires en Syrie en coordination avec les ministres syriens et les responsables de la défense, ainsi qu’avec les généraux russes, avait, selon The New York Times du 8 janvier, un rôle plus influent que celui du commandant en chef de la Force Al-Qods des Gardiens de la Révolution, qui supervise le réseau des milices régionales soutenues par l’Iran.
Il dit lors de cette réunion qu'il a quitté la Syrie à bord du dernier avion militaire pour Téhéran juste la nuit avant la chute de Damas aux mains des rebelles. Il révèle que les relations de l'Iran avec Bachar al-Assad ont été tendues durant les derniers mois de son régime. Assad a rejeté les multiples demandes des milices soutenues par l'Iran d'ouvrir à partir de la Syrie un nouveau front contre Israël après l'attaque du Hamas du 7 octobre. L'Iran lui a présenté des plans militaires complets sur l'utilisation de ses moyens militaires en Syrie pour attaquer Israël, précise le général. Il accuse aussi la Russie de les avoirs trompés en assurant que ses avions bombardaient les rebelles syriens alors qu'ils larguaient leurs bombes sur des champs. Il rappelle que dans le passé, lors qu'Israël frappait des cibles iraniennes en Syrie, les Russes avaient éteint leurs radars, facilitant ainsi ces attaques.
La Syrie était un centre de commandement régional de l’Iran. Celui-ci distribuait à partir de ce centre argent et armes à son réseau de milices, dont le Hezbollah libanais et les militants palestiniens. L’Iran contrôlait les aéroports et les dépôts d’armements et disposait des bases de fabrication de missiles et de drones. Sa perte est pour l’Iran l’effondrement d’une stratégie régionale bâtie année après année depuis le début de la république islamique.
Pour ne pas désespérer totalement son auditoire, le général Esbati affirme que l'Iran dispose encore de réseaux de militants qu'il pourra, si nécessaire, activer si le nouveau régime lui devenait hostile. C'est ce qu'il a fait en Irak, avec un succès indéniable, en formant et armant des milices chiites pour les lancer contre les forces américano-britanniques. Mais l'Iran n'a pas de frontière avec la Syrie, et la frontière irako-syrienne est peuplée d'Arabes sunnites et de Kurdes qui n'ont aucune sympathie envers le régime chiite iranien. Ses alliés potentiels, les alaouites, vivent sur la côte méditerranéenne, et la capacité de nuisance du Hezbollah libanais a été fortement réduite, l'empêchant de semer des troubles en Syrie.
Un autre message du général Esbati trouve une résonance particulière auprès du peuple iranien. Il estime que la chute du régime d'Assad était inévitable, étant donné la corruption rampante, l'oppression politique et les difficultés économiques auxquelles la population devait faire face, du manque d'électricité à l'essence et aux revenus insuffisants pour survivre. Bachar al-Assad a ignoré les avertissements et les appels à la réforme, et son régime s'est effondré.
Cette situation n'est pas sans rappeler en filigrane celle du régime iranien, qui reste sourd aux appels à la réforme, qui poursuit sa répression à l'intérieur, ses provocations et ses prises d'otages étrangers sans retenue.
Ainsi, le rappeur Amir Tataloo, 37 ans, est condamné à mort pour « insulte au Prophète » (AFP, 19 janvier). Deux femmes ont été arrêtées le 26 janvier pour « une danse contraire à la charia » dans un cimetière (NOU, p.80). Deux jeunes femmes kurdes, Pakhshan Azizi et Warisha Moradi, sont condamnées à mort pour « rébellion armée contre l'État » et pour leur appartenance présumée à des partis d'opposition kurdes. L'ONG Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme pour empêcher leur exécution, qui pourrait intervenir à tout moment.
Victime de « la diplomatie d’otage », la journaliste italienne Cecilia Sala a finalement été libérée contre la libération d'un ingénieur iranien, Mohammad Abedini Najafabadi, arrêté en février à la demande des autorités américaines, qui l'accusent d'avoir fourni à l'Iran des plans de fabrication de drones (The New York Times, 18 janvier).
Mais, trois otages français croupissent toujours dans les geôles iraniennes. Il s'agit de Cécile Kohler, professeure de français arrêtée en mai 2022 et accusée d'espionnage, ainsi que de Jacques Paris et d'un autre Français prénommé Olivier. Une situation jugée "inadmissible" par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui exige leur libération immédiate (L’Opinion, 10 janvier).
De son côté, le Parlement européen, dans une résolution d'urgence adoptée le 23 janvier, exige la libération de quatre otages européens, dont trois Français détenus en Iran (RFI, 23 janvier).
L'Iran ignore ces appels mais se dit prêt à négocier avec les Occidentaux sur son programme nucléaire et sur la levée des sanctions. Un énième round de discussions ont eu lieu les 13 et 14 janvier à Genève entre les représentants français, britanniques et allemands. Ces discussions ont été qualifiées de "franches et constructives" par les deux camps.
Cependant, les trois pays européens avaient évoqué en décembre le possible recours à un mécanisme réimposant des sanctions contre l'Iran « pour l'empêcher d'acquérir l'arme nucléaire ». Téhéran a averti que si les Européens utilisaient cet outil contre l'Iran, son adhésion au Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) "n'aurait plus de sens" (Le Figaro, 30 janvier). Chacun attend la position de l'administration Trump sur ce dossier sensible et prioritaire.
En attendant, le régime iranien veut renforcer sa main. Les présidents russe et iranien ont signé, le 17 janvier à Moscou, un "traité de partenariat stratégique global". Cet accord a des volets militaires et économiques. L'accord indique qu'en cas d'attaque contre l'Iran ou la Russie, les signataires du traité ne donneront aucune aide militaire ou autre à l'agresseur, ce qui faciliterait la continuation de l'agression.
Mais contrairement aux accords de défense signés par Mouscou avec d'autres alliés, le traité avec l'Iran n'inclut pas de clause de défense mutuelle. Après sa rencontre avec le président iranien, Vladimir Poutine a déclaré que l'accord avec l'Iran crée "des bases supplémentaires, importantes et sérieuses pour bâtir des relations mutuelles basées sur la confiance".
En fait, la Russie tient à rester prudente pour ne pas froisser ses importants partenaires arabes, comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. De ce fait, malgré de multiples demandes, elle n'a toujours pas livré à Téhéran des systèmes de défense anti-aérienne S-400 ni des avions de chasse de dernière génération. De plus, les deux réacteurs nucléaires en construction à Bushehr depuis des années ne sont toujours pas achevés.
Le seul élément nouveau et stratégique du nouvel accord est le projet de construction d'un "corridor de transport" reliant Saint-Pétersbourg à Bombay par route, voie ferroviaire et bâteaux, permettant à la Russie de commercer sans passer par la Méditerranée. Mais aucun calendrier ni plan de financement n'a été annoncé pour ce projet ambitieux, reliant la Caspienne au Golfe arabo-persique puis à l'océan Indien.
Autre projet annoncé : la construction d'un "hub" (entrepôt de stockage) pour le gaz russe en Iran, afin de faciliter la vente du gaz russe en Asie en évitant les sanctions occidentales. Moscou avait fait une proposition alléchante similaire à la Turquie pour s'attirer les bonnes grâces de son président. Une proposition qui reste toujours "à l'étude".
L'Iran courtise aussi la Chine, son principal partenaire commercial, qui a consenti à lui fournir des produits chimiques nécessaires à la production de propergol, le carburant des missiles balistiques. Les raïds israéliens d’octobre dernier avaient, entre autres cibles, détruit le principal centre de production de propergol, notamment les mélangeurs, des machines utilisées pour amalgamer les composants du propergol solide, qui seraient difficiles à remplacer.
Suite à ces dégâts, la production des missiles à combustion solide iraniens pourrait être interrompue pendant au moins un an, selon The Wall Street Journal. L'Iran comptait en 2023 plus de 3 000 missiles balistiques. Selon le quotidien L'Opinion du 27 janvier, citant des sources bien informées, deux navires iraniens ont chargé en Chine deux cargaisons de produits chimiques pouvant produire suffisamment de propergol pour la propulsion de 280 missiles iraniens de moyenne portée.
Pour impressionner et dissuader ses adversaires, l'Iran ne cesse de faire étalage de sa puissance militaire. Le 18 janvier, la flotte maritime des Gardiens de la révolution a dévoilé un dépôt souterrain de navires, situé "dans les eaux du sud du pays", "capables de frapper des destroyers américains". Cette installation se trouve à une profondeur de 500 mètres (Le Figaro, 18 janvier).
Le 10 janvier, le chef des Gardiens de la révolution, le général Hossein Salami, avait effectué une visite télévisée d'une base souterraine de missiles. L'Iran se prépare donc à une confrontation militaire.